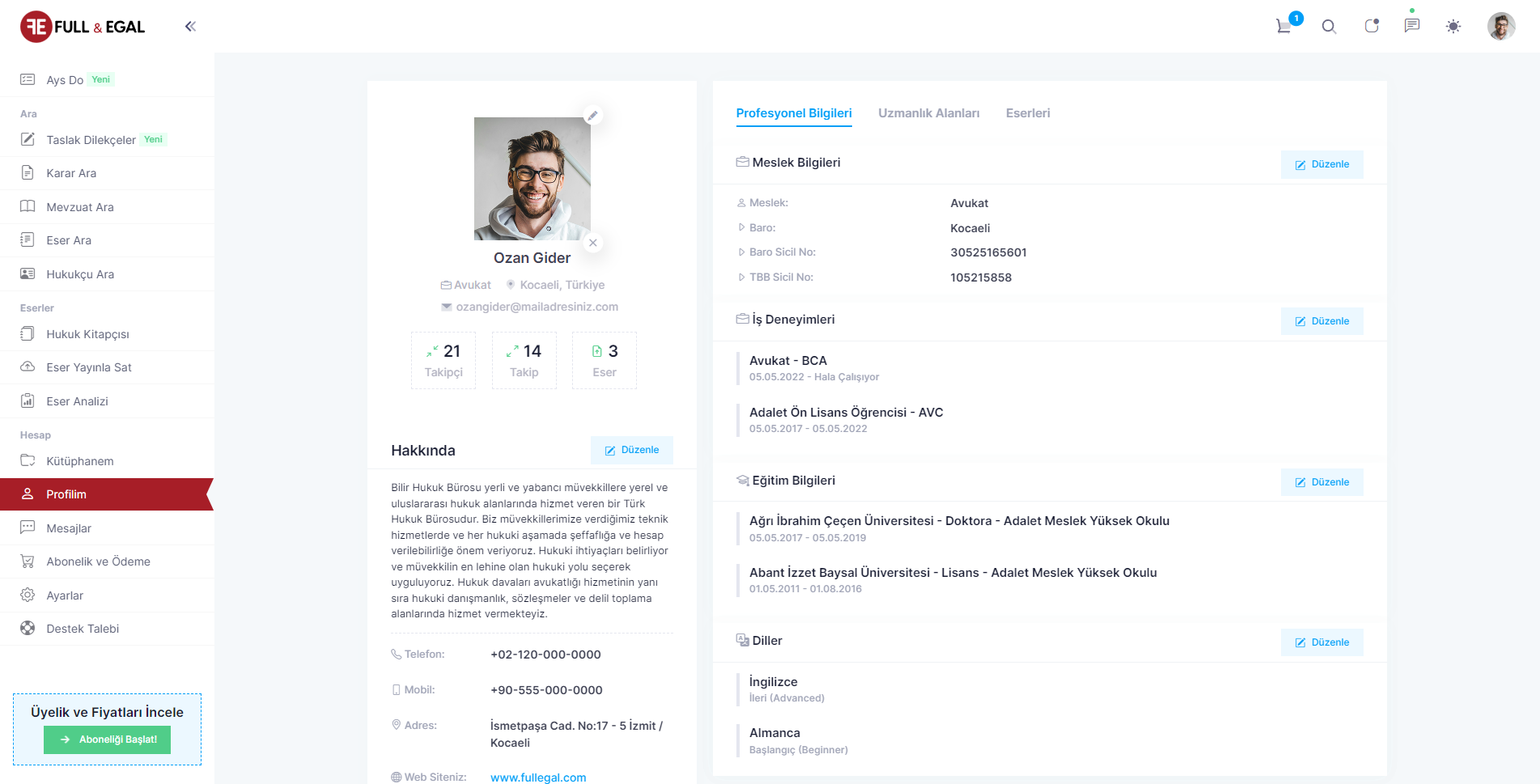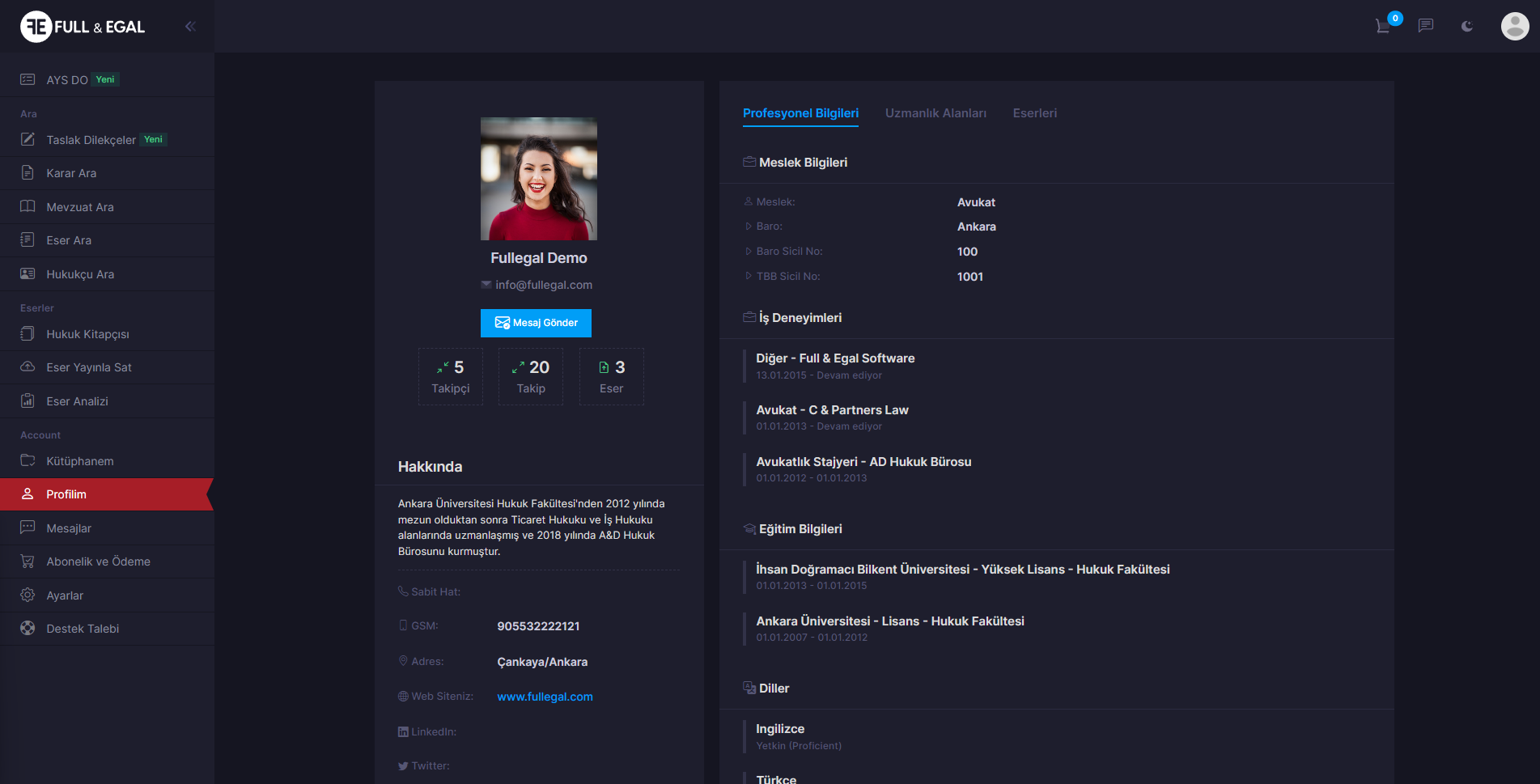ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
10 novembre 2017 ( *1 )
« Concurrence – Ententes – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens – Décision constatant six infractions à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Manipulation des taux de référence interbancaires JPY LIBOR et Euroyen TIBOR – Restriction de concurrence par objet – Participation d’un courtier aux infractions – Procédure “hybride” de transaction – Principe de présomption d’innocence – Principe de bonne administration – Amendes – Montant de base – Adaptation exceptionnelle – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑180/15,
Icap plc, établie à Londres (Royaume-Uni),
Icap Management Services Ltd, établie à Londres,
Icap New Zealand Ltd, établie à Wellington (Nouvelle-Zélande),
représentées par Mes C. Riis-Madsen et S. Frank, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, B. Mongin et Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2015) 432 final de la Commission, du 4 février 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39861 – Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes dans ladite décision,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg, F. Schalin, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1
Les requérantes, Icap plc, Icap Management Services Ltd et Icap New Zealand Ltd, font partie d’une entreprise de services de courtage par l’entremise de réseaux vocaux et électroniques qui est également un fournisseur de services de post-négociation (ci-après « Icap »).
2
Par sa décision C(2015) 432 final, du 4 février 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39861 – Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a retenu qu’Icap avait participé à la réalisation de six infractions à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE concernant la manipulation des taux de référence interbancaires London Interbank Offered Rate (LIBOR, taux interbancaire pratiqué à Londres) et Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR, taux interbancaire pratiqué à Tokyo) sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais, lesquelles avaient été préalablement constatées par la décision C(2013) 8602 final de la Commission, du 4 décembre 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39861 – Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens) (ci-après la « décision de 2013 »).
3
Le 17 décembre 2010, UBS AG et UBS Securities Japan (ci-après, prises ensemble, « UBS ») ont saisi la Commission d’une demande d’octroi d’un marqueur au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »), en l’informant de l’existence d’une entente dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais.
4
Le 24 avril 2011, le 18 novembre 2011, le 28 septembre 2012 et le 3 décembre 2012, Citigroup Inc. et Citigroup Global Markets Japan Inc. (ci-après, prises ensemble, « Citi »), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (ci-après « DB »), R. P. Martin Holdings et Martin Brokers (UK) Ltd ainsi que The Royal Bank of Scotland (ci-après « RBS ») ont respectivement présenté des demandes au titre de la communication sur la coopération (considérants 47 à 50 de la décision attaquée). Le 29 juin 2011 et le 12 février 2013, la Commission a octroyé à UBS et à Citi une immunité conditionnelle en application du paragraphe 8, sous b), de ladite communication (considérants 45 et 47 de ladite décision).
5
Le 12 février 2013, en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), la Commission a engagé une procédure d’infraction contre UBS, RBS, DB, Citi, R. P. Martin Holdings et Martin Brokers (UK) ainsi que JP Morgan Chase & Co., JP Morgan Chase Bank, National Association and J. P. Morgan Europe Ltd (considérant 51 de la décision attaquée).
6
Le 29 octobre 2013, la Commission a adressé une communication des griefs aux sociétés visées au point 5 ci-dessus (considérant 52 de la décision attaquée).
7
En application de la procédure de transaction prévue à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 (JO 2008, L 171, p. 3), la Commission a adopté la décision de 2013, par laquelle elle a conclu que les sociétés visées au point 5 ci-dessus avaient violé les dispositions de l’article 101 TFUE et de l’article 53 EEE, en participant à des accords ou à des pratiques concertées ayant pour objet de restreindre ou de fausser la concurrence dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais.
A. Procédure administrative à l’origine de la décision attaquée
8
Le 29 octobre 2013, en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, la Commission a engagé une procédure d’infraction à l’encontre des requérantes (considérant 53 de la décision attaquée).
9
Le 31 octobre 2013, une réunion visant à parvenir à une transaction au sens de l’article 10 bis du règlement no 773/2004 s’est tenue, au cours de laquelle la Commission a présenté aux requérantes les griefs qu’elle envisageait de retenir à l’encontre d’Icap ainsi que les preuves principales en sa possession qui les sous-tendaient (considérant 54 de la décision attaquée).
10
Le 12 novembre 2013, les requérantes ont informé la Commission de leur intention de ne pas opter pour une procédure de transaction (considérant 55 de la décision attaquée).
11
Le 6 juin 2014, la Commission a adressé aux requérantes une communication des griefs. Ces dernières y ont répondu le 14 août 2014 ainsi que lors de l’audition qui s’est tenue le 12 septembre 2014 (considérants 58 et 59 de la décision attaquée).
12
Le 4 février 2015, la Commission a adopté la décision attaquée, reprochant à Icap d’avoir « facilité » six infractions et lui imposant six amendes pour un montant total de 14960000 euros.
B. Décision attaquée
1. Produits en cause
13
Les infractions en cause portent sur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais indexés sur le JPY LIBOR ou sur l’Euroyen TIBOR. Le JPY LIBOR est un ensemble de taux d’intérêt de référence pratiqué à Londres (Royaume-Uni) qui, au moment de l’adoption de la décision attaquée, était établi et publié par la British Bankers Association (BBA, Association des banquiers britanniques) et utilisé pour de nombreux produits financiers libellés en yens japonais. Il est calculé à partir des offres de prix présentées quotidiennement par un panel de banques membres de ladite association (ci-après le « panel JPY LIBOR »). Lesdites offres permettent d’établir le taux « moyen » à partir duquel chaque banque, membre dudit panel, pourrait emprunter des fonds en demandant et en acceptant des offres interbancaires pour un volume raisonnable. À partir des informations communiquées par lesdites banques et en excluant les quatre références les plus élevées et les quatre références les moins élevées, la BBA établissait ainsi les taux journaliers du JPY LIBOR. L’Euroyen TIBOR est un ensemble de taux d’intérêt de référence pratiqué à Tokyo (Japon) qui remplit une fonction équivalente, mais est calculé par la Japanese Banker Association (JBA, Association des banquiers japonais) à partir des offres d’un panel des membres de ladite association et en excluant les deux références les plus élevées ainsi que les deux les moins élevées. La Commission a retenu que les taux du JPY LIBOR et de l’Euroyen TIBOR constituent une composante des prix des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais. Ils peuvent affecter le niveau de numéraire qu’une banque va devoir verser ou va recevoir à l’arrivée à échéance du terme de sa contrepartie ou à des intervalles spécifiques. Les produits dérivés les plus fréquents sont les contrats de garantie de taux, les swaps de taux d’intérêt, les options sur taux d’intérêt et les contrats à terme de taux d’intérêt (voir considérants 9 à 19 de la décision attaquée).
2. Comportements reprochés à Icap
14
Les comportements reprochés à Icap consistent dans la « facilitation » de six infractions, à savoir :
–
l’« infraction UBS/RBS de 2007 », entre le 14 août et le 1er novembre 2007 ;
–
l’« infraction UBS/RBS de 2008 », entre le 28 août et le 3 novembre 2008 ;
–
l’« infraction UBS/DB », entre le 22 mai et le 10 août 2009 ;
–
l’« infraction Citi/RBS », entre le 3 mars et le 22 juin 2010 ;
–
l’« infraction Citi/DB », entre le 7 avril et le 7 juin 2010 ;
–
l’« infraction Citi/UBS », entre le 28 avril et le 2 juin 2010.
15
En premier lieu, la Commission a, notamment, retenu qu’Icap était active en tant que courtier sur le marché des dépôts en espèces de yens japonais, par l’intermédiaire de son guichet « Cash/Money Market desk », basé à Londres. Dans le cadre de cette activité, elle fournirait des estimations aux acteurs dudit marché tant sur les volumes disponibles que sur les prix, dont l’objet serait de faciliter la conclusion d’accords entre ces acteurs. S’agissant plus précisément des estimations fournies par Icap auxdits acteurs, la Commission a relevé, en substance, que celles-ci incluaient ses estimations quant aux taux du JPY LIBOR du jour, sous la forme d’un bulletin communiqué à des établissements financiers, dont certains membres du panel JPY LIBOR. Elle a considéré ledit bulletin comme ayant disposé d’une influence significative sur le comportement des banques à l’occasion de l’émission de leurs offres de taux (considérants 98 à 101 de la décision attaquée).
16
En deuxième lieu, la Commission a relevé qu’Icap était également un courtier sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais, ce rôle étant exercé par un guichet particulier. Elle a estimé que certains des traders opérant au sein de ce guichet, outre des transactions légitimes avec M. H., trader d’UBS puis de Citi, ont également, à la demande de ce dernier, tenté d’affecter les cours du JPY LIBOR soit par une modification du bulletin en cause, soit en utilisant les contacts d’Icap avec certaines banques du panel JPY LIBOR (considérants 102 et 103 de la décision attaquée).
17
En troisième lieu, la Commission a estimé que cela avait conduit Icap à faciliter la réalisation des six infractions constatées dans la décision de 2013 (considérants 165 à 171 de la décision attaquée). S’agissant, premièrement, des infractions UBS/RBS de 2007, UBS/RBS de 2008 et UBS/DB, elle a relevé qu’un trader d’UBS avait utilisé les services d’Icap aux fins d’influencer les offres de certaines banques membres du panel JPY LIBOR ne participant pas à ces trois ententes. À cet égard, elle a reproché à Icap d’avoir utilisé ses contacts avec les banques membres dudit panel dans le sens recherché par UBS et d’avoir disséminé des informations erronées portant sur les futurs taux du JPY LIBOR [considérant 77, sous a) et b), et considérants 106 à 141 de ladite décision]. S’agissant, deuxièmement, des infractions Citi/UBS et Citi/DB, elle a retenu qu’un trader de Citi avait utilisé les services d’Icap aux fins d’influencer les offres de certaines banques membres de ce panel ne participant pas à ces deux ententes. Dans ce cadre, elle a également reproché à Icap d’avoir utilisé ses contacts avec les banques membres du même panel et d’avoir disséminé des renseignements erronés [considérant 83, sous a) et b), et considérants 154 à 164 de cette décision]. S’agissant, troisièmement, de l’infraction Citi/RBS, elle a reproché à Icap d’avoir servi de moyen de communication entre un trader de Citi et un trader de RBS aux fins de faciliter sa réalisation (considérants 84 et 142 à 153 de la même décision).
3. Calcul de l’amende
18
La Commission a rappelé de manière liminaire que, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), le montant de base de l’amende doit être déterminé eu égard au contexte dans lequel l’infraction a été commise ainsi que, en particulier, à la gravité et à la durée de l’infraction et que le rôle joué par chacun des participants doit faire l’objet d’une évaluation individuelle tout en reflétant d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes (considérant 284 de la décision attaquée).
19
La Commission a observé que les lignes directrices de 2006 ne fournissaient que peu d’orientations sur la méthode de calcul de l’amende pour les facilitateurs. Étant donné qu’Icap était un opérateur actif sur les marchés de service de courtage, et non sur celui des produits dérivés de taux d’intérêt, elle a estimé qu’elle ne pouvait pas substituer les frais de courtage à ceux des prix des produits dérivés de taux d’intérêt en yens japonais, pour établir le chiffre d’affaires et fixer le montant de l’amende, dès lors qu’une telle substitution ne reflèterait pas la gravité ainsi que la nature de l’infraction. Elle en a déduit, en substance, qu’il convenait de faire application du paragraphe 37 des lignes directrices de 2006, qui permet de s’écarter de ces lignes directrices s’agissant de la détermination du montant de base de l’amende (considérant 287 de la décision attaquée).
20
Au vu de la gravité des comportements en cause et de la durée de participation d’Icap à chacune des six infractions en cause, la Commission a fixé, pour chacune d’entre elles, un montant de base de l’amende, à savoir 1040000 euros pour l’infraction UBS/RBS de 2007, 1950000 euros pour l’infraction UBS/RBS de 2008, 8170000 euros pour l’ infraction UBS/DB, 1930000 euros pour l’ infraction Citi/RBS, 1150000 euros pour l’ infraction Citi/DB et 720000 euros pour l’infraction Citi/UBS (considérant 296 de la décision attaquée).
21
En ce qui concerne la fixation du montant définitif de l’amende, la Commission n’a retenu l’existence d’aucune circonstance aggravante ou atténuante et a pris note du fait que le plafond de 10 % de chiffre d’affaires annuel n’avait pas été dépassé (considérant 299 de la décision attaquée). L’article 2 du dispositif de la décision attaquée inflige, dès lors, aux requérantes des amendes dont le montant définitif est équivalent à celui de leur montant de base.
II. Procédure et conclusions des parties
22
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.
23
Le 15 février 2016, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre), au titre des mesures d’organisation de la procédure, prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité les requérantes à répondre à une question relative à leur deuxième moyen, à la suite du prononcé de l’arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission (C‑194/14 P, EU:C:2015:717).
24
Le 29 février 2016, les requérantes ont répondu à la question posée par le Tribunal, en renonçant à une partie de leur deuxième moyen.
25
La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
26
Sur proposition de la deuxième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.
27
Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties et a demandé à la Commission de produire les demandes de transaction présentées par UBS au titre des infractions UBS/RBS de 2007 et UBS/RBS de 2008.
28
Le 30 novembre 2016, la Commission a refusé de déférer à la demande de production de documents. Par une ordonnance du 1er décembre 2016, le Tribunal a ordonné à la Commission de lui fournir ces deux documents. Conformément à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure et aux fins de concilier, d’une part, le principe du contradictoire et, d’autre part, les caractéristiques de la procédure de transaction, l’ordonnance du 1er décembre 2016 a limité la consultation de ces deux documents aux seuls représentants des parties au greffe, sans que des copies puissent en être faites. Le 7 décembre 2016, la Commission a déféré à la mesure d’instruction.
29
Le 8 et le 9 décembre 2016, les requérantes et la Commission, respectivement, ont répondu aux questions posées par le Tribunal. Le 31 décembre 2016 et le 5 janvier 2017, la Commission et les requérantes, respectivement, ont présenté leurs observations sur les réponses présentées par l’autre partie.
30
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 janvier 2017.
31
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
annuler en tout ou partie la décision attaquée ;
–
à titre subsidiaire, annuler ou réduire le montant des amendes infligées ;
–
condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés dans le cadre du présent litige ;
–
ordonner toute mesure que le Tribunal jugera appropriée.
32
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter le recours dans son intégralité ;
–
condamner les requérantes aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité d’un document et d’un chef de conclusions
33
La Commission conteste la recevabilité du quatrième chef de conclusions des requérantes ainsi que la recevabilité d’un courrier adressé au Tribunal.
1. Sur la recevabilité du quatrième chef de conclusions des requérantes
34
Par leur quatrième chef de conclusions, les requérantes demandent au Tribunal « d’ordonner toute mesure qu[’il] jugera appropriée ».
35
Pour autant qu’un tel chef de conclusions doive être interprété en une demande que le Tribunal adresse des injonctions à la Commission, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union européenne d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce. Il incombe à l’institution concernée, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (voir arrêt du 30 mai 2013, Omnis Group/Commission, T‑74/11, non publié, EU:T:2013:283, point 26 et jurisprudence citée).
36
Le quatrième chef de conclusions, pour autant qu’il inclue une demande d’injonction, doit, partant, être déclaré irrecevable.
2. Sur la contestation de la recevabilité d’un courrier des requérantes
37
Dans la duplique, la Commission soutient qu’un courrier des requérantes adressé au Tribunal et dont une copie lui a été communiquée directement par les requérantes doit être déclaré irrecevable en ce qu’il ne serait pas conforme aux dispositions du règlement de procédure.
38
Il suffit à cet égard de souligner que, par une décision en date du 2 mars 2016, il a été décidé de ne pas verser ledit courrier au dossier. La contestation de recevabilité de la Commission s’en trouve, dès lors, privée d’objet.
B. Sur les conclusions en annulation
39
Au soutien de la demande d’annulation de la décision attaquée, les requérantes avancent six moyens. Les quatre premiers moyens, portant respectivement, premièrement, sur l’interprétation et l’application de la notion de restriction ou de distorsion de concurrence « par objet » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, deuxièmement, sur l’application de la notion de « facilitation » aux circonstances de l’espèce, troisièmement, sur la durée des six infractions en cause et, quatrièmement, sur une violation des principes de la présomption d’innocence et de bonne administration, concernent la légalité de l’article 1er de ladite décision, relatif à l’existence desdites infractions. Les cinquième et sixième moyens, relatifs, respectivement, à la détermination du montant des amendes et à une violation du principe ne bis in idem, concernent la légalité de l’article 2 de cette décision, relatif aux amendes infligées par la Commission pour chacune de ces infractions.
1. Sur le premier moyen, tiré des erreurs dans l’interprétation et l’application de la notion de restriction ou de distorsion de concurrence « par objet » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE
40
Dans le cadre du premier moyen, les requérantes contestent la qualification d’infraction par objet appliquée aux comportements incriminés par la Commission, en ce que ceux-ci seraient insusceptibles d’avoir une influence sur la concurrence, et en déduisent qu’Icap ne saurait être tenue responsable de la « facilitation » d’une quelconque infraction.
41
La Commission conclut au rejet du présent moyen.
42
Dans la mesure où est en cause la qualification d’infractions par objet appliquée par la Commission, il convient de rappeler que, pour relever de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée doit avoir « pour objet ou pour effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur.
43
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 49, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 113 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C‑32/11, EU:C:2013:160, point 34).
44
En effet, certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 50, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 114 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C‑32/11, EU:C:2013:160, point 35).
45
Ainsi, il est acquis que certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent être considérés comme étant tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services qu’il peut être considéré inutile, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de démontrer qu’ils ont des effets concrets sur le marché. En effet, l’expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 115).
46
Dans l’hypothèse où l’analyse d’un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d’en examiner les effets et, pour l’interdire, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C‑32/11, EU:C:2013:160, point 34 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 52, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 116).
47
Selon la jurisprudence de la Cour, il convient, afin d’apprécier si un accord entre entreprises ou une décision d’association d’entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence « par objet » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 117 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C‑32/11, EU:C:2013:160, point 36).
48
En outre, bien que l’intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un accord entre entreprises, rien n’interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l’Union d’en tenir compte (arrêts du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C‑32/11, EU:C:2013:160, point 37 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 54, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 118).
49
En ce qui concerne plus particulièrement l’échange d’informations entre concurrents, il convient de rappeler que les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun (arrêts du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 32, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 119).
50
Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou attendu de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu’il a été décidé de tenir sur ce marché ou qu’il a été envisagé d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (arrêts du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 33, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 120).
51
La Cour a ainsi jugé que l’échange d’informations entre concurrents était susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténuait ou supprimait le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (arrêts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, point 89 ; du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 35, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 121).
52
En particulier, il y a lieu de considérer comme ayant un objet anticoncurrentiel un échange d’informations susceptible d’éliminer des incertitudes dans l’esprit des intéressés quant à la date, à l’ampleur et aux modalités de l’adaptation du comportement sur le marché que les entreprises concernées vont mettre en œuvre (arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 122 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 41).
53
Par ailleurs, une pratique concertée peut avoir un objet anticoncurrentiel bien qu’elle n’ait pas de lien direct avec les prix à la consommation. En effet, le libellé de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne permet pas de considérer que seules seraient interdites les pratiques concertées ayant un effet direct sur le prix acquitté par les consommateurs finaux (arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 123 ; voir également, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 36).
54
Au contraire, il ressort dudit article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE qu’une pratique concertée peut avoir un objet anticoncurrentiel si elle consiste à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction » (arrêts du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 37, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 124).
55
En tout état de cause, l’article 101 TFUE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle. Dès lors, la constatation de l’existence de l’objet anticoncurrentiel d’une pratique concertée ne saurait être subordonnée à celle d’un lien direct de celle-ci avec les prix à la consommation (arrêts du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, points 38 et 39, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 125).
56
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte des termes mêmes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE que la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises concernées, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments (arrêts du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 51, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 126).
57
À cet égard, la Cour a considéré qu’il y avait lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombait aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. En particulier, la Cour a conclu qu’une telle pratique concertée relevait de l’article 101, paragraphe 1, TFUE même en l’absence d’effets anticoncurrentiels sur ledit marché (arrêts du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 51, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 127).
58
En l’espèce, aux considérants 77 et 78 de la décision attaquée, la Commission a retenu que les six infractions en cause incluaient toutes deux formes de comportements, à savoir, d’une part, la discussion des soumissions d’au moins une des banques en vue d’influencer la direction de cette soumission et, d’autre part, la communication ou la réception d’informations commercialement sensibles concernant soit des positions de négociation, soit de futures soumissions d’au moins une des banques respectives. En outre, s’agissant de l’infraction UBS/DB, elle a également relevé, au considérant 78 de ladite décision, l’exploration par les banques de la possibilité de conclure des transactions visant à aligner leurs intérêts commerciaux en matière de produits dérivés et l’éventuelle conclusion, à de rares occasions, de telles transactions.
59
La Commission a retenu que les comportements litigieux avaient pour objet une manipulation des taux du JPY LIBOR, laquelle aurait permis une amélioration de la position des banques participantes sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais.
60
Aux considérants 13 à 17 de la décision attaquée, la Commission a souligné que les produits dérivés et notamment les contrats de garantie de taux et les swaps de taux d’intérêt disposaient de deux « jambes » ou « pattes », l’une correspondant à un flux à payer, l’autre à un flux à recevoir. L’une serait constituée par un taux fixe, l’autre par un taux variable. Une partie verserait à l’autre un paiement calculé sur la base du taux variable et recevrait un paiement déterminé sur la base du taux fixe déterminé lors de la conclusion, et inversement.
61
La Commission a relevé que la manipulation des taux du JPY LIBOR avait eu une incidence directe sur les recettes en numéraire (cash-flow) perçus ou versés au titre de la jambe « variable » des contrats visés au point 60 ci-dessus (considérants 199 et 201 de la décision attaquée), dès lors que ceux-ci étaient calculés directement par référence auxdits taux.
62
La Commission a considéré que la manipulation des taux du JPY LIBOR avait eu une incidence également sur la jambe « fixe » des contrats visés au point 60 ci-dessus, dans la mesure où le niveau actuel desdits taux était indirectement reflété dans le taux fixe des futurs contrats, dès lors, en substance, que ceux-ci constituaient une estimation de ce que seraient ces taux dans le futur (considérants 200 et 201 de la décision attaquée).
63
Dans la décision attaquée, la Commission a retenu que la coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR ainsi que l’échange d’informations confidentielles entre les banques participantes correspondaient à une restriction de la concurrence devant normalement s’effectuer entre elles, ayant abouti à une distorsion de la concurrence à leur profit et au détriment des banques non participantes. Cela aurait ainsi permis la création d’une situation d’« information asymétrique » au profit des seules banques participantes, leur permettant de proposer des contrats dans de meilleures conditions que les autres banques intervenant sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais (considérants 202 à 204 de ladite décision). Les comportements litigieux auraient ainsi faussé la concurrence au profit des banques participantes et au détriment des autres acteurs dudit marché. La Commission en a déduit que les six infractions en cause disposaient du degré de nocivité suffisant pour être qualifiées d’infractions par objet (considérants 219 et 220 de cette décision).
64
À l’encontre de cette analyse, les requérantes mettent en exergue la définition restrictive de la notion d’infraction par objet retenue dans la jurisprudence de la Cour. Elles soutiennent que les comportements en cause ne présentent pas un degré de nocivité pour le jeu normal de la concurrence dans le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais justifiant leur qualification d’infractions par objet. Elles ajoutent que les échanges d’informations reprochés ne constituent pas un comportement ayant « pour objet » de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Elles soulignent également que certains éléments pertinents pour la qualification d’infraction par objet auraient été mis en exergue pour la première fois au considérant 200 de la décision attaquée. Enfin, elles estiment que, s’agissant de l’infraction UBS/DB, la Commission n’a pas démontré la conclusion de transactions entre les banques visant à aligner leurs intérêts commerciaux en matière de produits dérivés et n’a pas qualifié ce comportement de constitutif d’un échange d’informations.
65
Dans la mesure où, pour les six infractions en cause, la Commission a retenu l’existence à la fois d’une coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR et d’un échange d’informations confidentielles, il suffit de vérifier si l’un de ces deux comportements dispose d’un objet anticoncurrentiel.
66
En ce qui concerne le premier comportement commun aux six infractions en cause, à savoir la coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR, il convient de relever que c’est à juste titre que la Commission a constaté que les paiements dus par un établissement financier à un autre, au titre d’un produit dérivé, étaient soit directement, soit indirectement, liés aux niveaux des taux du JPY LIBOR.
67
Ainsi, en ce qui concerne, en premier lieu, les paiements dus au titre des contrats en cours, l’incidence des taux du JPY LIBOR peut être considérée comme relevant de l’évidence. Elle concerne les paiements dus au titre de la jambe « variable » des contrats visés au point 60 ci-dessus, lesquels sont directement basés sur lesdits taux. Ainsi, à leur égard, une coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR pouvait conduire à influencer le niveau desdits taux dans un sens favorable aux intérêts des banques à l’origine de ladite coordination, ainsi que l’a retenu, en substance, la Commission aux considérants 199 et 201 de la décision attaquée.
68
En ce qui concerne, en second lieu, les paiements dus au titre des contrats futurs, force est de constater que c’est également à bon droit que la Commission a retenu que la coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR avait une incidence sur les paiements dus au titre de la jambe « fixe » des contrats visés au point 60 ci-dessus.
69
D’une part, il convient de relever qu’aux considérants 34 à 44 et 200 de la décision attaquée, la Commission a explicité les raisons pour lesquelles le niveau des taux du JPY LIBOR avait une incidence sur la jambe « fixe » des contrats visés au point 60 ci-dessus. En substance, elle a relevé que la détermination des taux fixes s’appréciait en une projection, basée sur formule mathématique, de la courbe de rendement actuelle des produits dérivés, elle-même fonction des niveaux actuels des taux du JPY LIBOR.
70
D’autre part et par voie de conséquence, il peut être considéré qu’une coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR permettait aux banques y participant de réduire grandement l’incertitude quant aux niveaux auxquels se situeraient les taux du JPY LIBOR et, partant, leur fournissait un avantage concurrentiel à l’occasion de la négociation et de l’offre de produits dérivés par rapport aux banques n’ayant pas participé à ladite coordination, ce que la Commission a justement relevé aux considérants 201 à 204 de la décision attaquée.
71
Il ressort de ce qui précède que la coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR est pertinente pour les paiements dus au titre des contrats visés au point 60 ci-dessus tant en ce qui concerne leur jambe « variable » que leur jambe « fixe ».
72
Force est de constater qu’une telle coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR, en ce qu’elle est destinée à influencer l’étendue des paiements dus par les banques concernées, ou devant leur être versés, recèle clairement un objet anticoncurrentiel.
73
Dans la mesure où les six infractions en cause incluent toutes une coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR, laquelle est de nature à justifier la qualification d’infraction par objet retenue par la Commission, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’autre comportement commun auxdites infractions, à savoir l’échange d’informations confidentielles, est également de nature à justifier une telle qualification.
74
En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, EU:C:2001:408, point 27, et du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T‑155/04, EU:T:2006:387, point 47).
75
En toute hypothèse, au vu de l’importance de l’incidence du niveau des taux du JPY LIBOR sur le montant des paiements effectués au titre tant de la jambe « variable » que de la jambe « fixe » des contrats visés au point 60 ci-dessus, force est de constater que la seule communication d’informations concernant les soumissions futures d’une banque membre du panel JPY LIBOR était susceptible de fournir un avantage aux banques concernées, les éloignant de l’application du jeu normal de la concurrence sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais d’une manière telle que cet échange d’informations peut être considéré comme ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en application de la jurisprudence citée aux points 49 à 52 ci-dessus. Le même raisonnement est applicable au comportement portant sur l’échange d’informations confidentielles concernant les soumissions futures relatives à l’Euroyen TIBOR, retenu par la Commission dans le cadre de la seule infraction Citi/UBS.
76
Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la Commission a retenu que les six infractions en cause étaient restrictives de concurrence de par leur objet.
77
Cette conclusion n’est pas infirmée par les différents arguments avancés par les requérantes.
78
Il en est ainsi, en premier lieu, de la réfutation par les requérantes de la nocivité pour le jeu normal de la concurrence des comportements litigieux.
79
Premièrement, c’est à tort que les requérantes font valoir qu’il n’existe pas de relation de concurrence entre les banques sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais. La conclusion de contrats sur ledit marché impliquant une négociation desdits produits, et plus particulièrement du taux fixe applicable, il existe nécessairement un processus de concurrence s’agissant de l’offre de ces produits entre les différentes banques actives sur ce marché.
80
Deuxièmement, et par voie de conséquence, ne saurait non plus être suivie l’affirmation des requérantes tirée d’une prétendue contrariété entre, d’une part, la possibilité pour les banques concernées de proposer de meilleures conditions que leurs concurrents et, d’autre part, la qualification d’infraction par objet. Au contraire, cette possibilité constitue plutôt la manifestation de l’altération du processus concurrentiel sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais au profit des banques ayant participé à la collusion.
81
Troisièmement, est dépourvue de pertinence la mise en exergue par les requérantes de ce que les banques concluent un nombre important de transactions dans lesquelles elles adoptent des positions opposées. En effet, l’un des intérêts d’une manipulation des taux du JPY LIBOR, s’agissant plus particulièrement des contrats en cours, est de permettre que celui-ci reflète le mieux possible les intérêts des banques concernées, à savoir un taux élevé en cas de position nette créditrice et bas en cas de position nette débitrice.
82
En deuxième lieu, les requérantes allèguent, en substance, une violation de leurs droits de la défense en ce que certains éléments pertinents pour la qualification d’infraction par objet auraient été mis en exergue pour la première fois au considérant 200 de la décision attaquée.
83
Certes, en application d’une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (voir arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T‑111/08, EU:T:2012:260, point 265 et jurisprudence citée).
84
L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 reflète ce principe, dans la mesure où il prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission et de faire valoir utilement leur défense avant que celle-ci n’adopte une décision définitive. Cette exigence est respectée dès lors que ladite décision ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer (voir arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T‑111/08, EU:T:2012:260, point 266 et jurisprudence citée).
85
Toutefois, cette indication peut être donnée de manière sommaire et la décision finale ne doit pas nécessairement être une copie de la communication des griefs, car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire. Sont ainsi admissibles des ajouts à la communication des griefs effectués à la lumière de la réponse des parties, dont les arguments démontrent qu’elles ont effectivement pu exercer leurs droits de la défense. La Commission peut également, au vu de la procédure administrative, réviser ou ajouter des arguments de fait ou de droit à l’appui des griefs qu’elle a formulés (voir arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T‑111/08, EU:T:2012:260, point 267 et jurisprudence citée).
86
Ainsi, la communication aux intéressés d’un complément de griefs n’est nécessaire que dans le cas où le résultat des vérifications amène la Commission à mettre à la charge des entreprises des actes nouveaux ou à modifier sensiblement les éléments de preuve des infractions contestées (voir arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T‑111/08, EU:T:2012:260, point 268 et jurisprudence citée).
87
Enfin, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, il y a violation des droits de la défense lorsqu’il existe une possibilité que, en raison d’une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle ait pu aboutir à un résultat différent. Une entreprise requérante établit qu’une telle violation a eu lieu lorsqu’elle démontre à suffisance non pas que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité, par exemple en raison du fait qu’elle aurait pu utiliser pour sa défense des documents dont l’accès lui a été refusé lors de la procédure administrative (voir arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T‑111/08, EU:T:2012:260, point 269 et jurisprudence citée).
88
En l’espèce, d’une part, il convient de relever que la référence à une fixation indirecte des prix figurant au considérant 200 de la décision attaquée ne revêt pas le caractère nouveau allégué par les requérantes. Certes, les points 137 et 175 de la communication des griefs auxquels la Commission se réfère ne sauraient être considérés comme l’explicitation d’un grief tiré d’une fixation indirecte des prix en ce qu’ils constituent un simple rappel des principes juridiques gouvernant l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Néanmoins, il ressort de la lecture de la communication des griefs que la substance de l’argumentation qui y figure était la même que celle présentée dans ladite décision, et notamment au considérant 200 de cette dernière, à savoir l’incidence du niveau du JPY LIBOR sur le niveau des taux applicables aux contrats futurs (voir, en particulier, le point 157 de la communication des griefs). Les requérantes ont, dès lors, été en mesure de présenter leurs observations à l’égard de ce grief au cours de la procédure administrative.
89
D’autre part, s’agissant de l’allégation tirée du caractère nouveau de la référence, au considérant 200 de la décision attaquée, au fait que la manipulation du JPY LIBOR constituerait également une fixation des conditions de transaction au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE, il convient d’observer que, pour les raisons exposées aux points 66 à 76 ci-dessus, les incidences de cette manipulation sur le niveau des paiements dus au titre de produits dérivés suffisent à justifier la qualification d’infractions par objet retenue par la Commission. Partant, il ne saurait être considéré que l’éventuelle absence de possibilité pour les requérantes de présenter leur observations à l’égard du grief tiré d’une fixation des conditions de transaction les aurait empêchées de mieux assurer leur défense au sens de la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus.
90
En troisième lieu, s’agissant des critiques diligentées par les requérantes à l’encontre de la constatation par la Commission de l’existence d’un comportement consistant dans l’exploration par les banques de la possibilité de conclure des transactions visant à aligner leurs intérêts commerciaux en matière de produits dérivés et de l’éventuelle conclusion, à de rares occasions, de telles transactions, laquelle ne concerne que l’infraction UBS/DB, il ressort de la lecture du considérant 78 de la décision attaquée que ledit comportement n’a été envisagé par la Commission que comme visant à faciliter la coordination des futures soumissions auprès du panel JPY LIBOR. Dans la mesure où ce comportement n’apparaît pas revêtir un caractère autonome par rapport à celui de ladite coordination dont l’objet anticoncurrentiel a été démontré à suffisance de droit, il n’est pas nécessaire de répondre à cet aspect de l’argumentation des requérantes.
91
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs dans l’application de la notion de « facilitation » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de la jurisprudence
92
Les requérantes estiment que c’est à tort que la Commission a retenu qu’Icap avait facilité les six infractions en cause. À la suite du prononcé de l’arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission (C‑194/14 P, EU:C:2015:717), elles ont renoncé à une partie de leur argumentation, de sorte que le présent moyen est désormais constitué de trois branches.
93
Par la première branche du deuxième moyen, laquelle ne concerne pas l’infraction Citi/RBS, mais seulement les cinq autres infractions en cause, les requérantes soutiennent que le critère de « facilitation » appliqué à Icap est trop large, nouveau et viole le principe de sécurité juridique. Par la deuxième branche dudit moyen, laquelle concerne les cinq mêmes infractions, elles soutiennent que le rôle joué par Icap ne répond pas aux critères jurisprudentiels de la « facilitation ». Enfin, par la troisième branche de ce moyen, laquelle ne concerne que les infractions UBS/RBS de 2007, Citi/UBS et Citi/DB, elles contestent le bien-fondé des motifs de la décision attaquée pris de l’utilisation par Icap de ses contacts auprès de plusieurs banques aux fins d’influencer leurs soumissions auprès du panel JPY LIBOR.
94
Le Tribunal estime qu’il convient d’analyser, d’abord, les deuxième et troisième branches du présent moyen, dès lors qu’elles concernent, en substance, le caractère infractionnel des comportements reprochés à Icap, et, ensuite, la contestation de la conformité au principe de sécurité juridique du caractère infractionnel retenu, contenue dans la première branche dudit moyen.
a) Sur la deuxième branche, tirée de la méconnaissance par la Commission des critères jurisprudentiels de la « facilitation »
95
Les requérantes, dans le cadre de la présente branche, soutiennent, en substance, que la conclusion tirée de ce que le comportement d’Icap relevait du champ d’application de l’article 101 TFUE est erronée.
96
La Commission conclut au rejet de la présente branche.
97
Il convient de rappeler que rien dans le libellé de l’article 101, paragraphe 1, TFUE n’indique que l’interdiction qui y est énoncée vise uniquement les parties aux accords ou pratiques concertées qui sont actives sur les marchés affectés par ceux‑ci (arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 27).
98
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’existence d’un « accord » est fondée sur l’expression de la volonté concordante de deux parties au moins, la forme selon laquelle se manifeste cette concordance n’étant pas déterminante par elle‑même (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 28 et jurisprudence citée).
99
S’agissant de la notion de « pratique concertée », il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’article 101, paragraphe 1, TFUE distingue cette notion notamment de celle d’« accord » et de « décision d’association d’entreprises » dans le seul dessein d’appréhender différentes formes de collusion entre entreprises qui, du point de vue subjectif, partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 29 et jurisprudence citée).
100
En outre, lorsqu’il s’agit d’accords et de pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la Commission doit démontrer, afin de pouvoir conclure à la participation d’une entreprise à l’infraction et à sa responsabilité pour tous les différents éléments qu’elle comporte, que l’entreprise concernée a entendu contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 30 et jurisprudence citée).
101
À cet égard, la Cour a notamment jugé que les modes passifs de participation à l’infraction, tels que la présence d’une entreprise à des réunions au cours desquelles des accords ayant un objet anticoncurrentiel avaient été conclus, sans s’y être manifestement opposée, traduisent une complicité qui était de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors que l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, avait pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et de compromettre sa découverte (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 31 et jurisprudence citée).
102
Si la Cour a déjà relevé qu’un « accord » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE visait l’expression de la volonté concordante des parties de se comporter sur le marché d’une manière déterminée et que les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une « pratique concertée », au sens de la même disposition, devaient être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique devait déterminer de manière autonome la politique qu’il entendait suivre sur le marché commun, il ne ressort pas de ces considérations que les notions d’accord et de pratique concertée présupposent une limitation réciproque de la liberté d’action sur un même marché sur lequel seraient présentes l’ensemble des parties (arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, points 32 et 33).
103
En outre, il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que l’article 101, paragraphe 1, TFUE concerne uniquement soit les entreprises actives sur le marché concerné par les restrictions de la concurrence, ou encore sur des marchés situés en amont, en aval ou voisins dudit marché, soit les entreprises qui limitent leur autonomie de comportement sur un marché donné en vertu d’un accord ou d’une pratique concertée. En effet, il découle d’une jurisprudence bien établie de la Cour que le texte de l’article 101, paragraphe 1, TFUE se réfère de façon générale à tous les accords et les pratiques concertées qui, dans des rapports soit horizontaux, soit verticaux, faussent la concurrence dans le marché commun, indépendamment du marché sur lequel les parties sont actives, tout comme du fait que seul le comportement commercial de l’une d’entre elles soit concerné par les termes des arrangements en cause (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, points 34 et 35 et jurisprudence citée).
104
Il convient aussi de souligner que l’objectif principal de l’interdiction envisagée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE est d’assurer le maintien d’une concurrence non faussée à l’intérieur du marché commun et que sa pleine efficacité implique que soit appréhendée la contribution active d’une entreprise à une restriction de concurrence, alors même que cette contribution ne concerne pas une activité économique relevant du marché pertinent sur lequel cette restriction se matérialise ou a pour objet de se matérialiser (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 36 et jurisprudence citée).
105
En l’espèce, il importe d’emblée de relever que la Commission n’a pas retenu l’existence d’infractions autonomes entre Icap et UBS, puis Icap et Citi, dont l’objet aurait été de manipuler le niveau des soumissions des banques dans un sens conforme aux intérêts d’UBS, puis de Citi, par le biais de la propagation par Icap d’informations erronées. Dans la décision attaquée, la responsabilité d’Icap est engagée sur la base de sa participation aux comportements anticoncurrentiels relevés par la Commission, que cette dernière a qualifiée de « facilitation ».
106
Au vu du raisonnement suivi par la Commission dans la décision attaquée, il y a lieu de vérifier si la participation d’Icap remplit les critères mis en exergue par la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, dont seule la réunion est de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité au titre des infractions commises par les banques concernées.
107
À cet égard, il y lieu de relever que les requérantes contestent la réunion de ces critères dans le cadre de trois griefs tirés de ce que la Commission n’a pas démontré, premièrement, une connaissance par Icap de l’existence d’une collusion entre les banques concernées dans le cadre de certaines des six infractions en cause (premier grief), deuxièmement, l’existence d’une volonté de la part d’Icap de contribuer à l’objectif commun aux banques concernées (deuxième grief) et, troisièmement, qu’Icap aurait contribué à la réalisation des objectifs communs aux banques concernées (troisième grief). Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner, tout d’abord, le premier grief, puis le troisième grief et, enfin, le deuxième grief.
1) Sur le premier grief, relatif à l’absence de démonstration de la connaissance par Icap de l’existence d’une collusion entre les banques concernées dans le cadre de certaines des six infractions en cause
108
Dans le cadre du premier grief, les requérantes estiment que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence d’une connaissance par Icap d’une collusion entre les banques concernées dans le cadre des infractions UBS/RBS de 2007, UBS/RBS de 2008, Citi/DB et Citi/UBS, mais seulement, le cas échéant, des tentatives unilatérales d’un trader de manipuler les taux du JPY LIBOR.
109
Le présent grief ne concerne, dès lors, que quatre des six infractions en cause.
110
Les requérantes font valoir que les courts messages utilisés à titre d’élément de preuve par la Commission pourraient seulement démontrer qu’un trader de l’une des banques concernées était au courant des futures soumissions d’une autre banque. Dans un contexte marqué, notamment, par l’existence de contacts licites entre lesdites banques, il ne saurait en être déduit qu’Icap avait connaissance de la volonté commune de ces banques de coordonner leurs soumissions auprès du panel JPY LIBOR. Cela serait le cas pour les infractions UBS/RBS de 2007, UBS/RBS de 2008, Citi/DB et Citi/UBS.
111
Les requérantes soutiennent que la structure du marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais, laquelle implique des négociations continuelles entre les banques concernées, peut expliquer la connaissance par une banque donnée de la direction des soumissions d’une autre banque, sans que cette connaissance soit le produit d’un échange d’informations. Elles en déduisent qu’Icap pouvait raisonnablement estimer que les références à la position future d’une autre banque contenues dans les communications d’un trader n’était pas la conséquence d’une entente illicite. Elles reprochent à la Commission de ne pas avoir pris en compte cette possible interprétation des éléments de preuve, tant pour l’infraction UBS/RBS de 2007 que pour l’infraction UBS/RBS de 2008. S’agissant de la référence par la Commission à la reconnaissance par UBS du rôle de facilitateur d’Icap dans sa demande de transaction, elles font valoir, notamment, que la décision de transaction souligne explicitement que les faits acceptés par les parties ne peuvent établir aucune responsabilité en ce qui concerne Icap. En ce qui concerne les infractions Citi/DB et Citi/UBS, elles réitèrent que les éléments avancés ne démontrent pas l’existence d’une collusion entre les banques concernées durant la période infractionnelle retenue.
112
La Commission soutient que les considérants 214 à 221 de la décision attaquée démontrent à suffisance de droit qu’Icap avait conscience ou aurait dû avoir conscience que ses actions contribuaient à des infractions restreignant la concurrence. Pour chacune des six infractions en cause, Icap aurait été informée par UBS, puis par Citi, de l’identité de l’autre banque du panel JPY LIBOR avec laquelle elles entretenaient des contacts anticoncurrentiels. Cela serait le cas tant pour l’infraction UBS/RBS de 2007 que pour l’infraction UBS/RBS de 2008. S’agissant de ces dernières infractions, la Commission observe que la preuve de la connaissance par Icap de la collusion entre les banques concernées s’appuie également sur la reconnaissance par UBS dans sa demande de transaction du rôle de facilitateur d’Icap, figurant aux considérants 115 et 126 de la décision attaquée, reconnaissance non remise en cause par les requérantes. Elle se réfère également à la connaissance du marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais par Icap et à sa qualité de courtier principal sur ce marché pour souligner que la nature anticoncurrentielle de cette collusion ne pouvait être ignorée. En ce qui concerne les infractions Citi/DB et Citi/UBS, elle fait observer que les requérantes ne contestent pas la connaissance par Icap de la collusion entre les banques concernées, mais seulement la portée temporelle de celle-ci. Elle rappelle, à cet égard, que la date de commencement d’une infraction est celle de la collusion et non de sa mise en œuvre.
113
À cet égard, il y a lieu de relever que, en application de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, il appartenait à la Commission de démontrer qu’Icap avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par chacune des banques concernées ou pouvait raisonnablement les prévoir.
114
En outre, il convient de rappeler que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l’existence d’une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (voir arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 71 et jurisprudence citée).
115
Pour établir l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves sérieuses, précises et concordantes. Toutefois, chacune des preuves apportées par cette dernière ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par cette institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 47 et jurisprudence citée).
116
De plus, s’il subsiste un doute dans l’esprit du juge, il doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. En effet, la présomption d’innocence constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 72 et jurisprudence citée).
117
Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que le principe de la présomption d’innocence s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 73 et jurisprudence citée).
118
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, pour se demander si, d’après son contenu, il