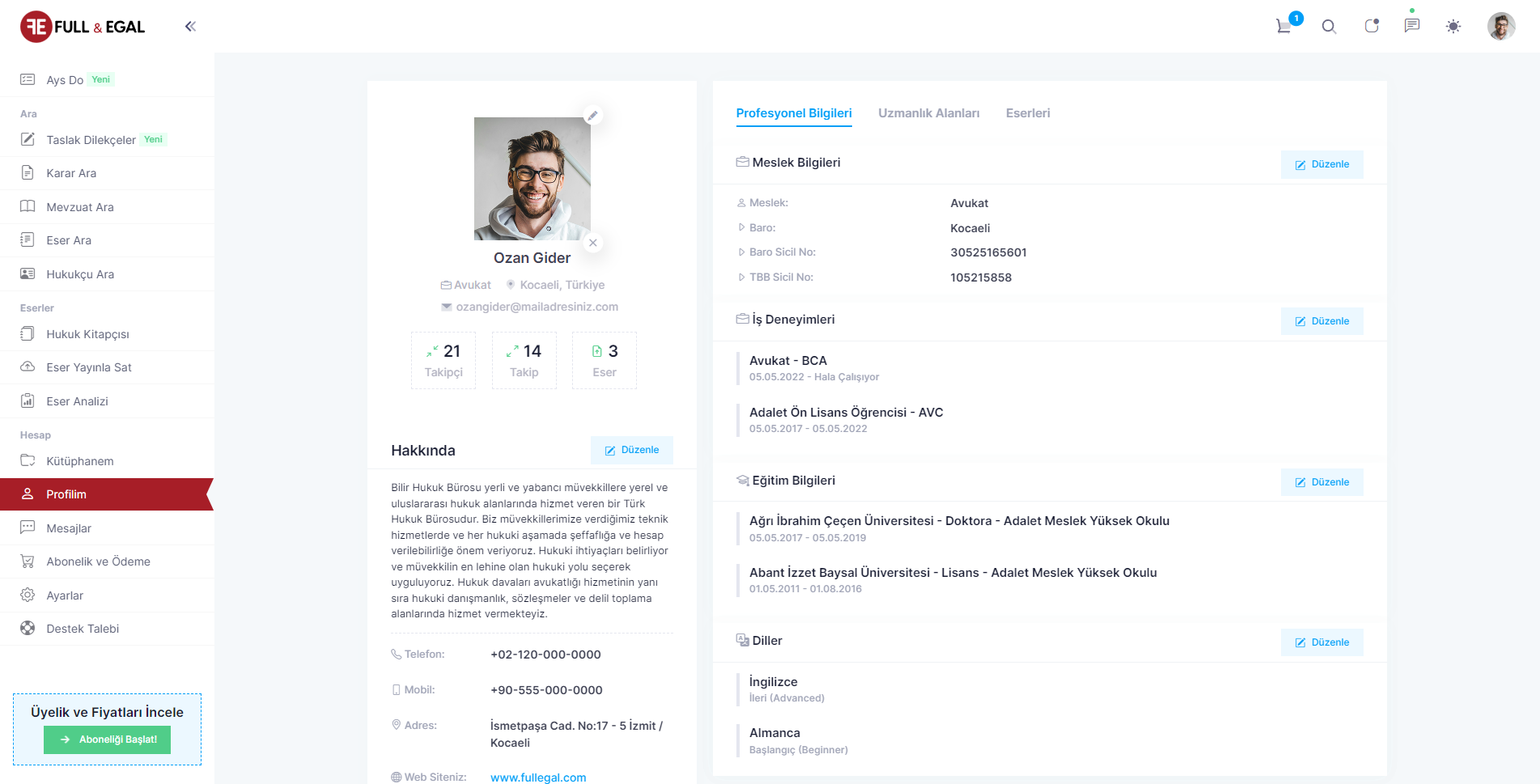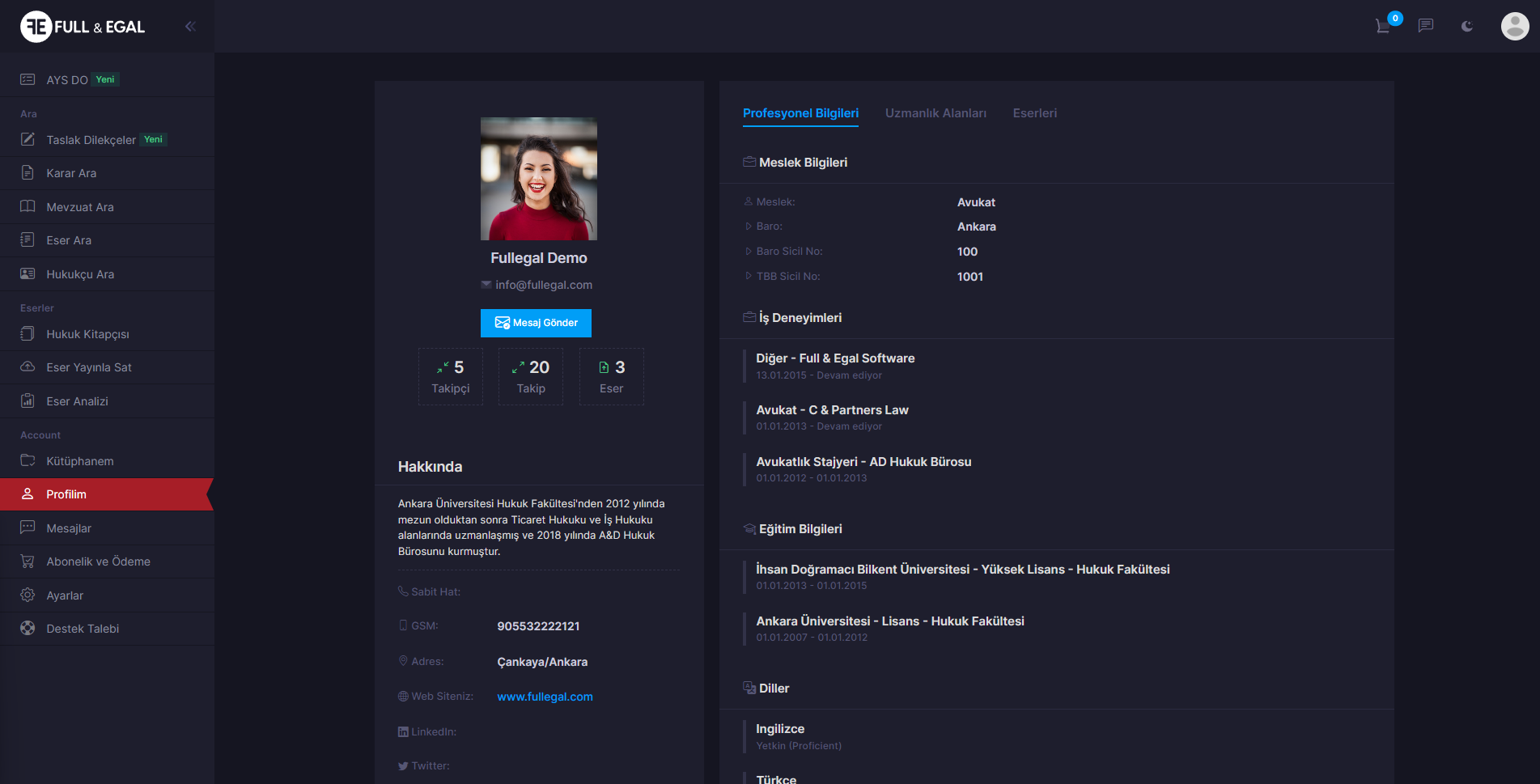CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
AUTOMOBILE ET DUPUY c. FRANCE
(Requête no 13353/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars 2009
DÉFINITIF
05/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hachette Filipacchi Presse Automobile et Dupuy c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13353/05) dirigée contre la République française. La société en nom collectif (S.N.C.) Hachette Filipacchi Presse Automobile, société de droit français, et M. Paul Dupuy, ressortissant français, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er avril 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par la S.C.P. Carole Thomas‑Raquin et Alain Bénabent, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent en particulier la violation de leur droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
4. Le 25 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien‑fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La SNC Hachette Filipacchi Presse Automobile, devenue Hachette Filipacchi Associés depuis 2005, est l’éditrice du magazine mensuel Action Auto Moto dont M. Paul Dupuy, le second requérant, était, au moment des faits, directeur de la publication et gérant. Le magazine cherche avant tout à comparer des voitures, principalement destiné à donner des conseils pour les achats d’automobiles. Selon la source AEPM 2006‑2007 (Association pour la promotion de la presse magazine, qui édite des études d’audience), le magazine s’adresse essentiellement à des hommes majeurs (79 % d’hommes et 55 % de personnes de plus de 35 ans).
6. Le siège social de la société requérante est situé à Levallois-Perret.
7. A la fin du mois de mars 2002 parut le numéro 88 d’Action Auto Moto.
8. En page 111 fut publiée une photographie du pilote de Formule 1, Michael Schumacher, célébrant sa victoire sur le podium du grand prix d’Australie. Le nom de la marque de tabac M., sponsor de son écurie, apparaissait sur la manche de sa combinaison. Sur la manche droite de la combinaison d’un autre pilote apparaissait la marque de cigarettes W. Les logos des deux marques de tabac mesurent chacun un centimètre environ, sur une page de format A4. Un des deux logos, situé à l’extrême droite de la page, est peu visible. Présents sur les combinaisons des pilotes, les logos s’inscrivent dans une photographie particulièrement colorée et au milieu d’autres insignes et logos de diverses marques, de taille équivalente. Des logos en faveur de marques d’alcool, de grande taille, sont placés en arrière‑plan et sont visibles tout autour du pilote.
9. Par des exploits d’huissier datés des 27 et 28 juin 2002 et des 27 et 28 mai 2003, le Comité national contre le tabagisme (C.N.C.T.) fit citer devant le tribunal de grande instance de Paris M. Dupuy, en qualité de prévenu, et la SNC Excelsior Filipacchi, en qualité de civilement responsable pour répondre des faits de publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou de ses produits, en vertu de la loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.
10. Par un jugement du 10 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Paris déclara M. Dupuy coupable des faits à l’origine de la poursuite et le condamna à une amende délictuelle de 30 000 euros (EUR). La SNC Excelsior Filipacchi fut déclarée solidairement responsable, en totalité, de l’amende mise à la charge de M. Dupuy. Les requérants furent également condamnés solidairement à verser au C.N.C.T. la somme de 1 000 EUR à titre de dommages et intérêts.
11. Le tribunal estima que le nom des marques de tabac apparaissait de façon insidieuse dans un environnement sportif, de compétition, de champions séduisant le grand public et en particulier les jeunes. Il releva que la présentation de telles photographies dans les magazines sous prétexte de présenter des images de sport était l’occasion d’une publicité indirecte en faveur des produits du tabac, laquelle était interdite. Il précisa qu’il importait peu que le diffuseur n’ait pas été rémunéré par les fabricants de tabac, l’impact des messages sur le public étant le même, que le diffuseur ait ou non perçu une rémunération pour cette diffusion. Selon lui, la réglementation de la publicité en faveur du tabac, insérée dans le chapitre du code de la santé publique consacré aux « fléaux sociaux », constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé justifiant une restriction de la liberté d’expression. Il précisa que la technique du « floutage », laquelle était largement utilisée pour préserver, entre autre, le droit à l’image, n’altérait que très peu les documents, permettant ainsi de fournir au public une information la plus complète possible. Il en conclut que M. Dupuy, en sa qualité, d’une part, de dirigeant de la société éditant et publiant le magazine concerné et, d’autre part, de directeur de publication, devait être déclaré personnellement responsable d’avoir laissé insérer la photographie susvisée portant la marque de deux fabricants de cigarettes alors qu’il lui appartenait de l’empêcher. Il avait nécessairement eu connaissance de la photographie incriminée, laquelle n’avait pu échapper à son attention. Le tribunal releva que lors de l’audience il avait indiqué que cette photographie avait été choisie, achetée et publiée en toute connaissance de cause. M. Dupuy avait donc, par son abstention fautive, fourni aux fabricants de tabac le support nécessaire à la commission du délit et s’était rendu lui‑même coupable de publicité illicite en faveur du tabac. Concernant l’article 14 de la Convention, le jugement fut motivé comme suit :
« Enfin, il n’y a pas de discrimination au sens de l’article 14 de la Convention, quand c’est la loi elle-même dans son article L. 3511-5 du code de la santé publique qui fait une différence entre presse écrite et retransmission télévisuelle de compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans un pays où la publicité pour le tabac est autorisée ; ainsi la discrimination ne saurait être invoquée lorsque la différence de traitement est justifiée, comme en l’espèce, par la spécificité des médias en cause ; qu’en effet, tandis que les moyens techniques ne permettent pas à l’heure actuelle de dissimuler les emblèmes, logos ou publicités sur les images retransmises, il est parfaitement possible de ne pas photographier de tels signes ou de les cacher sur les négatifs et de ne pas en retracer la présence dans des articles de journaux (...) ; qu’en tout état de cause, le téléspectateur, qui suit une course automobile se déroulant « en temps réel », même s’il s’agit d’une émission retransmise en différé, a son attention mobilisée par la progression des différents concurrents, à des vitesses qui réduisent sensiblement sa capacité à lire les publicités apposées sur les combinaisons des coureurs et sur leurs véhicules ; que tel n’est pas le cas de l’acheteur d’un magazine tel que « Action Auto Moto » qui peut s’attarder sur chaque photographie, en examiner les détails, voire, quand il s’agit d’un portrait pleine page de son coureur favori, la découper et l’afficher sur le mur de sa chambre. »
12. Le 17 juillet 2003, l’ensemble des parties interjeta appel de ce jugement.
13. Par un arrêt du 26 janvier 2004, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 10 juillet 2003 en toutes ses dispositions pénales et, le réformant sur les intérêts civils, condamna solidairement les requérants à verser au C.N.C.T. 10 000 EUR à titre de dommages et intérêts. Sur l’action publique, la cour considéra que les marques de tabac dont les noms étaient reproduits étaient suffisamment connues pour que la seule citation de leur nom rappelle les cigarettes commercialisées et incite à la consommation de ces produits. Elle releva que le principe de la liberté d’expression ne s’opposait pas à ce que le législateur en réglemente l’exercice en vue de le concilier avec d’autres règles ou principes et notamment celui de la sauvegarde de la santé publique. Elle considéra que l’autorisation de la retransmission, par les chaînes de télévision, des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, prévue par l’article L. 3511-5 du code de la santé publique, ne constituait nullement une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention et ne justifiait en rien la violation par la presse écrite des dispositions du code de la santé publique prohibant la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac. Sur l’action civile, elle estima que l’impact d’une telle présentation des marques de cigarettes, dans un magazine grand public prisé des plus jeunes, était important. Elle en conclut que le préjudice du C.N.C.T. qui combat précisément l’association d’idées « Tabac, Sport, Loisir, Réussite » n’était pas contestable.
14. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt.
15. Ils firent notamment valoir à l’appui de ce recours que leurs condamnations emportaient violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
16. Par une décision du 5 octobre 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était de nature à permettre l’admission de leur pourvoi.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS
A. Législation et jurisprudence internes
17. Les dispositions pertinentes du code de la santé publique, issues de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, sont les suivantes :
Article L. 3511-3
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
(...) Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1. »
Article L. 3511-4, alinéa 1
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1. »
Article L. 3511-5
« La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision. »
Article L. 3512-2
« Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 100 000 euros d’amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.
Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés (...) »
18. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2008, a eu l’occasion de se prononcer sur la question des rediffusions d’images d’événements sportifs intervenant plusieurs heures ou plusieurs jours après l’épreuve (Cass. Crim., 14 mai 2008, no 07-87.128). Elle a estimé que, bien que cela ne soit pas expressément précisé, l’article L. 3511-5 du code de la santé publique entendait limiter l’autorisation donnée aux chaînes de télévision de retransmettre les compétitions de sport mécanique aux strictes nécessités de l’information sportive sur la course et son environnement, donnée en temps réel ou dans des situations proches du temps réel. Dès lors, elle a précisé que cette autorisation ne saurait s’étendre aux diverses rediffusions d’images intervenant plusieurs heures ou plusieurs jours après l’épreuve, dans des conditions où il est techniquement possible de sélectionner les plans ou d’intervenir pour éviter ou dissimuler les références aux marques de produits du tabac ou logos rappelant ces marques. Les médias audiovisuels doivent prendre les mêmes précautions que les médias de presse écrite lorsqu’ils ne retransmettent pas la course au moment même où elle se déroule.
B. Droit communautaire
19. Le 6 juillet 1998, la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac au sein de l’Union européenne, fut adoptée. Par un arrêt du 5 octobre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) annula cette directive au motif de l’incompétence du législateur communautaire pour l’adopter (affaire C 376-98). L’avocat général, M. Fennelly, dans ses conclusions du 15 juin 2000, avait estimé que « le législateur communautaire avait des motifs raisonnables de croire qu’une large interdiction de la promotion du tabac aboutirait à une réduction significative des niveaux de consommation et contribuerait, ainsi, à protéger la santé publique ». Dans son arrêt, la Cour estima que la directive ne constituait pas une restriction disproportionnée à la liberté d’expression dans la mesure où elle imposait une large interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac. Elle ajouta cependant qu’il n’en allait pas de même de l’interdiction de la publicité pour les produits de diversification, et qu’il « n’allait pas de soi que la publicité pour les produits et services autres que le tabac portant des marques ou autres éléments distinctifs associés au tabac puisse avoir un effet sur le niveau de consommation de ces derniers produits, de manière globale ».
La directive 98/43/CE a été remplacée par la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 visant à harmoniser les dispositions des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Elle a pour objet de réglementer la publicité et le parrainage dans les médias et d’éliminer les entraves à la libre circulation des marchandises et des services. Désormais, l’apposition de publicité sur les panneaux d’un site sportif, mais aussi sur les véhicules ou les sportifs eux-mêmes, est interdite lors des manifestations ou activités ayant des effets transfrontaliers. Les articles pertinents sont les suivants :
Article 3
« Publicité dans les médias imprimés et dans les services de la société de l’information
1. La publicité dans la presse et d’autres médias imprimés est limitée aux publications exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac et aux publications qui sont imprimées et éditées dans des pays tiers, lorsque ces publications ne sont pas principalement destinées au marché communautaire. Toute autre publicité dans la presse et d’autres médias imprimés est interdite.
2. La publicité qui n’est pas autorisée dans la presse et d’autres médias imprimés n’est pas autorisée dans les services de la société de l’information. »
Article 4
« Publicité radiodiffusée et parrainage
1. Toutes les formes de publicité radiodiffusée en faveur des produits du tabac sont interdites.
2. Les émissions radiodiffusées ne font pas l’objet d’un parrainage par des entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer ou à vendre des produits du tabac. »
20. Par un arrêt du 12 décembre 2006, la C.J.C.E. se prononça sur des dispositions de la directive 2003/33/CE. Il s’agissait de l’affaire C‑380/03 ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 9 septembre 2003 par l’Allemagne contre le Parlement et le Conseil :
« 147 (...) Par ailleurs, compte tenu de l’obligation pour le législateur communautaire de garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes, [les articles 3 et 4 de la directive] ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
152 (...) Quant à l’interdiction du parrainage d’émissions radiodiffusées prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, il ne résulte pas des considérants de la directive ni, plus particulièrement, du cinquième de ces considérants qu’en ne limitant pas une telle mesure aux activités ou aux manifestations ayant des effets transfrontaliers, à l’instar de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 89/552, le législateur communautaire ait excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont il dispose dans ce domaine.
153 Cette interprétation n’est pas remise en cause par la thèse de la requérante selon laquelle de telles mesures d’interdiction aboutiraient à priver les entreprises de presse de recettes publicitaires importantes, voire contribueraient à la fermeture de certaines entreprises et porteraient atteinte, in fine, à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la CEDH.
154 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si le principe de la liberté d’expression est expressément reconnu par l’article 10 de la CEDH et constitue un fondement essentiel d’une société démocratique, il résulte toutefois du paragraphe 2 de cet article que cette liberté est susceptible de faire l’objet de certaines limitations justifiées par des objectifs d’intérêt général, pour autant que ces dérogations sont prévues par la loi, inspirées par un ou plusieurs buts légitimes au regard de ladite disposition et nécessaires dans une société démocratique, (...)
155 De même, ainsi que l’ont souligné à juste titre le Parlement, le Conseil et les parties intervenant à leur soutien, le pouvoir d’appréciation dont di