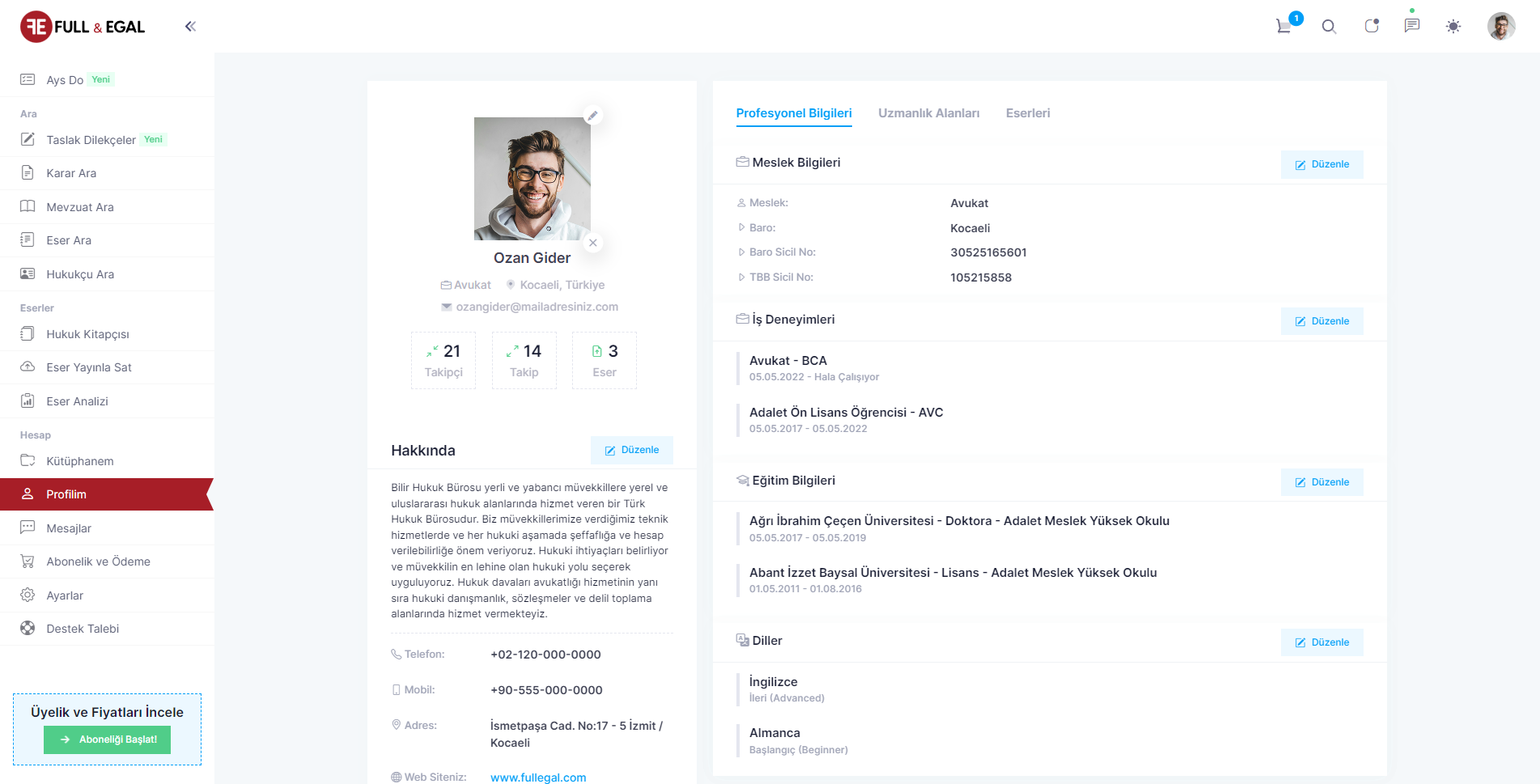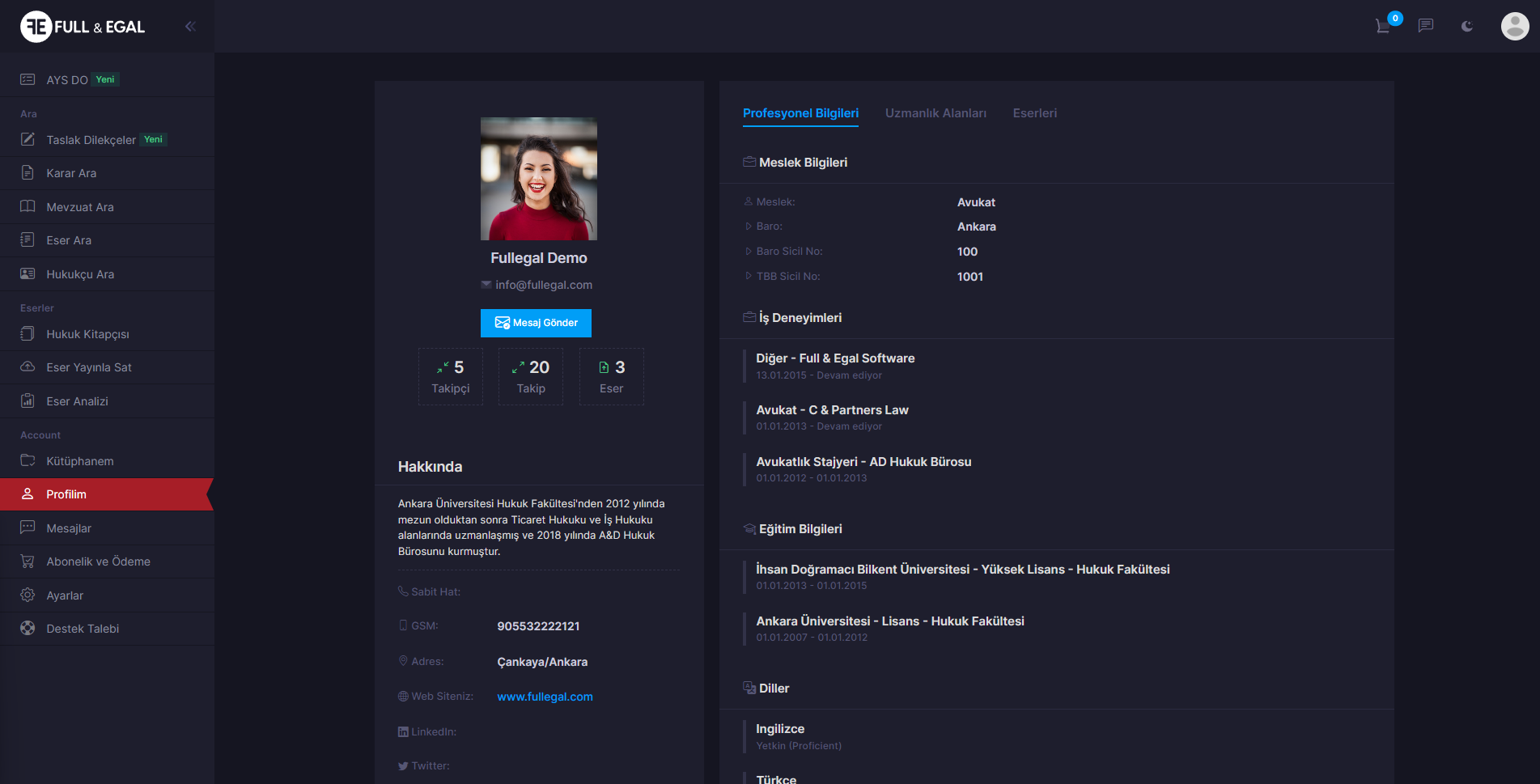DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VALLE PIERIMPIÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A. c. ITALIE
(Requête no 46154/11)
ARRÊT
(Fond)
STRASBOURG
23 septembre 2014
DÉFINITIF
23/12/2014
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Işıl Karakaş, présidente,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46154/11) dirigée contre la République italienne et dont une société anonyme de cet État, Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a., (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me U. Ruffolo, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. La requérante se plaint notamment d’avoir été privée de son « bien » (une vallée de pêche littorale, dite Valle Pierimpiè) sans indemnisation.
4. Le 18 juin 2013, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 a été communiqué au Gouvernement.
EN FAIT
5. La requérante acheta autrefois par un acte de vente notarié un complexe immobilier et productif dit Valle Pierimpiè, sis dans une lagune de la province de Venise. Ce complexe faisait partie de ce que l’on appelle localement les « vallées de pêche » (valli da pesca), expression désignant des terrains avec des étendues d’eau circonscrites par des barrières. Depuis lors, la requérante y exploite une forme particulière d’élevage piscicole.
6. Le 24 juin 1989, puis à nouveau le 10 juin 1991 et le 27 avril 1994, la direction provinciale de l’administration des finances (intendenza di finanza) de Padoue intima à la requérante de quitter les terrains qu’elle occupait, au motif que ces derniers appartenaient au domaine public (demanio publico).
A. La procédure de première instance
7. Le 24 juin 1994, la requérante assigna les ministères des Finances, des Transports, de la Navigation et des Travaux publics devant le tribunal de Venise afin d’obtenir une déclaration lui reconnaissant la qualité de propriétaire de la Valle Pierimpiè. Dans les motifs de son action, la requérante énonçait :
– que cette vallée de pêche avait été transmise par voie de ventes entre particuliers depuis des temps immémoriaux, comme en attestaient des titres remontant au XVe siècle ;
– qu’en 1886, elle avait été mise en vente par le tribunal civil de Venise ;
– qu’elle avait toujours été une propriété privée, ainsi qu’il ressortait de la législation autrichienne (la Vénétie faisait partie de l’empire austro-hongrois jusqu’en 1866) et des inscriptions dans le registre immobilier public et le cadastre.
8. Par un jugement du 18 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mai 2004, le tribunal déclara que la vallée de pêche Valle Pierimpiè appartenait au domaine de l’État ; en conséquence de quoi, le tribunal déclara la requérante redevable envers l’administration d’une indemnité pour occupation sans titre du domaine public, dont le montant devrait être fixé à l’issue d’une procédure civile séparée.
9. Dans ses motifs, le tribunal observa tout d’abord :
– qu’aux termes de l’article 28 du code de la navigation (ci‑après, le « CN »), le domaine public maritime (« DPM ») de l’État était formé, entre autres, par les lagunes et les bassins d’eau qui, au moins à une certaine période de l’année, communiquent librement avec la mer, et par les canaux dont l’utilisation correspond aux usages publics de la mer ;
– qu’en particulier, les lagunes appartenaient à l’État indépendamment du caractère public ou privé de leur utilisation, ce qui était confirmé par les dispositions spéciales concernant la lagune de Venise, notamment l’article 1 du décret-loi royal no 1853 de 1936 et l’article 1 de la loi no 366 de 1963 ;
– mais que ces lois ne précisaient pas la nature juridique des vallées de pêche, qui étaient des bassins séparés de la lagune.
10. Le tribunal nota toutefois que la jurisprudence avait clarifié les paramètres d’appréciation de la domanialité des vallées de pêche ; pour appartenir au domaine de l’État, celles-ci devaient remplir les conditions suivantes : a) faire physiquement partie de la lagune et donc de la mer, avec laquelle elles devaient communiquer ; b) se prêter à l’un des usages publics de la mer.
S’appuyant dans ce cadre sur les résultats d’une expertise ordonnée au cours du procès, le tribunal parvint à la conclusion :
– que la vallée de pêche Valle Pierimpiè ne faisait pas partie de la lagune de Venise et ne communiquait presque pas avec l’extérieur ;
– mais que la vallée communiquait avec la mer à l’époque de l’entrée en vigueur du CN (1942).
Or, nota le tribunal, l’appartenance au domaine de l’État ne pouvait cesser tacitement : un acte formel de l’administration était indispensable.
Il restait donc à déterminer si, par sa morphologie, la vallée en question était apte aux « usages publics de la mer » (usi pubblici del mare), à savoir, la navigation, la pêche et la baignade.
Sur ce point, le tribunal reconnut que la navigation et la baignade étaient de facto impossibles ou difficiles ; mais il observa qu’en revanche, la pêche d’élevage était couramment exercée dans la vallée. Cela suffisait, à ses yeux, pour affirmer que la Valle Pierimpiè faisait partie du DPM.
B. L’appel
11. La requérante fit appel de ce jugement.
12. Par un arrêt du 3 avril 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juin 2008, la cour d’appel de Venise confirma la décision de première instance.
13. Dans ses motifs, la cour d’appel observa que selon le règlement de police de la lagune (regolamento di polizia lagunare) de 1841, la lagune de Venise était considérée comme faisant partie du domaine de l’État, y compris les vallées de pêche. Dès lors, celles-ci ne pouvaient pas être objet de propriété privée et ne pouvaient être exploitées qu’en vertu d’une autorisation administrative.
Dans ces conditions, conclut la cour, les transferts de propriété que la requérante s’efforçait de prouver devaient être considérés comme nuls et non avenus car ils avaient pour objet des biens hors commerce ne pouvant pas être acquis par voie d’usucapion : comme l’avait précisé dans sa jurisprudence la Cour de cassation (troisième section, arrêt du 8 mars 1976), toute inscription de mutations de propriété au registre immobilier public et au cadastre devait céder face à l’appartenance du bien au DPM.
Le fait qu’avant 1989 l’administration n’était jamais intervenue pour revendiquer la Valle Pierimpiè et ne s’était pas opposée aux activités qui y étaient pratiquées, précisa-t-elle, ne changeait rien à cet état des choses.
14. Par ailleurs, jugea la cour, les vallées de pêche répondaient aux critères fixés à l’article 28 du CN. Il s’agissait en effet de bassins d’eau qui, pendant une période au moins de l’année, communiquaient librement avec la mer, même si cela n’était possible que grâce à la mise en œuvre de mécanismes hydrauliques installés par des particuliers. La clôture de la vallée effectuée après la deuxième guerre mondiale n’avait pas créé, aux yeux de la cour, une séparation effective et définitive par rapport au restant de la lagune de Venise.
15. La cour d’appel souligna également que les vallées étaient utilisées pour la pêche et que la navigation n’y était pas complètement exclue (elle pouvait être pratiquée par des bateaux de petit gabarit).
Enfin, considéra la cour, le but de la législation concernant la lagune de Venise était de la conserver et d’en protéger l’équilibre environnemental précaire. La poursuite de ce but ne permettait pas, jugea-t-elle, de soustraire certaines parties de la lagune (spazi acquei lagunari) à l’intérêt public.
16. La cour d’appel précisa cependant que ne faisaient partie du DPM que les parties de la vallée couvertes par les eaux, et non les terres et les constructions qui s’y trouvaient bâties.
Pour le reste, indiqua la cour, c’était à bon droit que la direction provinciale de l’administration des finances avait intimé à la requérante de quitter la vallée de pêche, l’inertie antérieure de l’administration étant sans incidence sur la légalité de sa démarche.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation dont la requérante était redevable, la cour d’appel considéra que celui-ci ne pouvait être fixé que dans le cadre d’une procédure civile séparée.
C. Le pourvoi en cassation
17. La requérante se pourvut en cassation. L’affaire fut attribuée par la Cour de cassation à sa formation de sections réunies.
18. Par un arrêt du 24 novembre 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 18 février 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés.
19. Dans ses motifs, la Cour de cassation rappela :
– qu’aux termes des articles 822 et 824 du code civil (« CC »), les biens du domaine public devaient nécessairement appartenir à l’État, aux régions, aux provinces et aux communes ;
– que certains de ces biens étaient identifiés par leurs seules qualités intrinsèques (ainsi du domaine dit « nécessaire » : domaine maritime, domaine hydrique et domaine militaire), d’autres par l’entrée en considération de la qualité de leur propriétaire (ainsi du domaine dit « éventuel », qui concerne par exemple les routes et les immeubles d’intérêt historique et artistique) ;
– que l’article 823 du CC prévoyait que les biens du domaine public étaient inaliénables et ne pouvaient faire l’objet de droits en faveur de tiers que selon les modalités et les limites établies dans les lois les concernant ; et que, dès lors, ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une acquisition par usucapion.
20. La Cour de cassation nota qu’aux termes de l’article 9 de la Constitution, la République protégeait le paysage et le patrimoine historique et artistique de la nation et l’État avait une compétence législative exclusive en matière de protection de l’environnement, de l’écosystème et des biens culturels.
Partant, jugea-t-elle, il s’imposait d’interpréter la notion de « biens publics » au-delà d’une vision purement patrimoniale, en se plaçant plutôt dans une perspective personnelle et collectiviste (prospettiva personale-collettivistica) et en ayant égard à la fonction de ces biens : dès lors que, par ses caractéristiques environnementales, un bien était destiné à la réalisation des buts constitutionnels de l’État, ce bien devait nonobstant tout titre de propriété (prescindendo dal titolo di proprietà) être considéré comme « commun » – c’est-à-dire, voué à la réalisation des intérêts de tous les citoyens.
La Cour de cassation nota également que, certes, la règle selon laquelle les biens de l’État étaient « hors commerce » n’était plus absolue et souffrait plusieurs exceptions.
21. Mais en l’espèce, considéra-t-elle, les vallées de pêche avaient une fonctionnalité et un but publics et collectifs ; leur appartenance à l’État impliquait l’obligation, pour ce dernier, de les destiner de manière effective à un usage public afin de réaliser les valeurs inscrites dans la Constitution.
Se référant à sa propre jurisprudence, la Cour de cassation nota que par ses arrêts nos 1863 de 1984 et 1300 de 1999, elle avait affirmé que la condition de la « communication libre avec la mer », requise par l’article 28 du CN pour établir si un bien faisait partie du domaine de l’État, ne devait pas être interprétée de manière physique et morphologique, mais par rapport à la fonction du bien en question. En particulier, il était déterminant d’établir si le plan d’eau pouvait se prêter aux « usages de la mer ».
Citant également son arrêt no 1228 de 1990, la Cour de cassation rappela que l’inclusion d’un bien dans le domaine naturel de l’État dépendait uniquement de ses caractéristiques intrinsèques, telles que décrites par la loi, sans que soit nécessaire l’intervention d’un acte administratif ad hoc.
Les actes privés de mutation de ces biens étaient nuls et non avenus, et toute conduite (comportamenti concludenti) éventuelle de l’administration pouvant être interprétée comme la reconnaissance d’une propriété privée sur ces biens, indiqua-t-elle, était contraire à la loi et donc sans importance.
Enfin, nota-t-elle, la loi no 366 de 1963 avait prévu la protection de la lagune de Venise et l’interconnexion fonctionnelle entre les vallées et la lagune pour la pêche.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
22. La requérante se plaint d’avoir été privée sans indemnisation de la vallée de pêche qu’elle exploitait, et d’avoir au contraire été reconnue débitrice envers l’État d’une indemnité pour occupation sans titre de celle-ci, dont le montant pourrait être très élevé.
Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
23. Le Gouvernement conteste toute violation de cette disposition.
A. Sur la recevabilité
1. Sur la compatibilité ratione materiae du grief avec l’article 1 du Protocole no 1
a) L’exception du Gouvernement
24. Selon le Gouvernement, la requérante n’a jamais été titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il expose que :
– la Valle Pierimpiè avait été incluse dans la délimitation de la lagune de Venise opérée par le décret du Sénat de la République de Venise du 10 janvier 1783, devenant ainsi un bien du domaine de l’État, caractérisé par son indisponibilité ;
– en 1791, des bornes furent posées pour indiquer les limites de la lagune ;
– le fait que la lagune et ses vallées faisaient partie du domaine fut confirmé par le règlement de police de la lagune de 1841, qui posait sur la base de cette appartenance à l’État le principe qu’aucun sujet privé ne pouvait exercer le droit de pêche d’une manière exclusive dans une vallée sans y être habilitée par un titre régulier (en l’occurrence, une concession de l’autorité) ;
– la Valle Pierimpiè faisait partie de la lagune tant selon le cadastre De Bernardi de 1843 que selon la carte hydrographique de 1932 ;
– le CN de 1942 n’a rien changé à cet égard, et les lois successives (notamment la loi no 366 du 5 mars 1963 et le décret du ministère des Travaux publics du 9 février 1990) ont confirmé la domanialité des vallées de pêche incluses dans la lagune ;
– sur la base des documents produits devant eux, les tribunaux italiens ont estimé à juste titre que la vallée en question était une « vallée ouverte », où la pêche s’exerçait comme dans les eaux libres.
25. La Valle Pierimpiè faisant ainsi partie du DPM, comme l’a par ailleurs établi la Cour de cassation dans son arrêt du 24 novembre 2010, le Gouvernement explique que la requérante ne peut avoir été titulaire d’aucun droit de propriété sur ce bien ; en effet, aucun droit réel, y compris par usucapion, ne peut être inscrit sur les biens du DPM, qui sont hors commerce.
Les décisions prises par le magistrat des eaux de Venise, observe-t-il, se référaient non pas au « propriétaire » mais à l’« usager » (utente) de la vallée de pêche et concernaient sa conservation et la réalisation d’ouvrages en vue de son exploitation économique. Selon la loi italienne, un tel « usager » peut bénéficier de subventions et autres contributions étatiques ou communautaires.
26. Le Gouvernement rappelle qu’un DPM existe dans douze des seize États côtiers observés par la Cour dans l’arrêt Depalle c. France ([GC], no 34044/02, §§ 52-53, 29 mars 2010).
Par ailleurs, dans la mesure où la requérante conteste l’établissement des faits et l’interprétation du droit interne retenus par les juridictions nationales, ses allégations relèvent selon lui de la quatrième instance.
27. Le Gouvernement soutient également que n’ayant ni obtenu une concession publique d’exploitation (article 36 du CN) ni payé la contribution (canone) prévue par la loi (article 39 du CN), la requérante ne saurait être titulaire d’une « espérance légitime » de continuer à utiliser la vallée de pêche.
De plus, selon lui, la requérante ne saurait se placer maintenant sur ce terrain (celui de l’atteinte à un prétendu droit d’ « utiliser » la vallée), car elle n’a pas introduit de demande dans ce sens devant les juridictions nationales (elle s’est en effet toujours bornée à clamer un droit de « propriété »).
28. D’après le Gouvernement, plusieurs éléments permettent de distinguer la présente affaire de l’affaire Bölükbaş et autres c. Turquie ((fond) no 29799/02, 9 février 2010), invoquée par la requérante (paragraphe 33 ci‑après). Il explique notamment :
a) qu’en droit italien, contrairement à ce qui est en droit turc, l’inscription d’une acquisition dans les registres immobiliers n’est pas « constitutive » d’un droit de propriété ;
b) qu’un bien fait partie du domaine de l’État même s’il n’a pas été inscrit comme tel dans les registres immobiliers, et que toute tolérance de l’État par rapport à son occupation et à son utilisation par des particuliers est sans importance à cet égard.
Le Gouvernement en déduit que l’inertie de l’administration, qui n’a pas tout de suite revendiqué l’appartenance du bien au DPM, ne saurait avoir créé aucune expectative valable chez la requérante. Toute personne agissant avec une diligence normale était selon lui en mesure de savoir que le bien appartenait au DPM depuis 1783.
À cet égard, le Gouvernement rappelle que le procès pénal entamé contre les notaires et les officiers publics responsables d’avoir donné acte du transfert de la vallée de pêche s’est soldé par une relaxe pour absence de dol, et non pour inexistence du fait reproché.
29. Un bien ne cesse d’appartenir au DPM que par un acte administratif formel et explicite de déclassement (declassificazione). En l’espèce, un tel acte n’a jamais été adopté. De plus, en droit italien, les impôts fonciers sont payés par la personne qui utilise le bien (par exemple, elles incombent à l’usufruitier, et non au nu-propriétaire) ; l’assujettissement à ces impôts ne saurait donc s’analyser en une preuve de la propriété.
30. Quant à l’affirmation de la requérante (paragraphe 32 ci‑après) selon laquelle l’État aurait reconnu comme « propriétés privées » d’autres vallées de pêche, à savoir les vallées Dragojesolo et Scanarello, le Gouvernement observe que cette reconnaissance a eu lieu sur la base d’aspects physiques et morphologiques qui ne sont pas comparables, d’après lui, à ceux de la Valle Pierimpiè. La requérante n’a d’ailleurs pas produit devant la Cour de cassation les deux exemples qu’elle cite devant la Cour.
b) Les arguments de la requérante
31. La requérante observe que les juridictions italiennes ont déclaré que la Valle Pierimpiè faisait partie du DPM, et ce malgré :
– l’existence d’actes de cession depuis le XVe siècle ;
– la possession continue des vallées par des personnes privées ;
– l’inscription des titres de propriété dans le registre immobilier public et le cadastre ;
– la conduite de l’administration, qui avait délivré des autorisations impliquant que la vallée appartenait à des propriétaires privés ;
– la perception par l’État des taxes et impôts sur la propriété, même après l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2010 ;
– le fait que selon l’expertise déposée au cours du procès de première instance, la vallée ne satisfaisait pas aux conditions indiquées à l’article 28 du CN (à savoir, qu’elle ne communiquait pas avec la mer et ne pouvait pas se prêter aux usages typiques de la mer (la navigation, la baignade et la pêche de poissons libres)) ;
– le fait que selon le règlement de police de la lagune de 1841, les vallées étaient possédées par des particuliers et pouvaient être acquises par voie d’usucapion.
32. La requérante affirme que l’État a reconnu comme « propriétés privées » deux vallées de pêche (les vallées « Dragojesolo » et « Scanarello ») selon elle tout à fait analogues à celle qu’elle revendiquait.
Considérant que le Gouvernement admet (paragraphe 24 ci‑dessus) que le CN de 1942 n’a pas changé la destination des vallées de pêche de la lagune de Venise, la requérante conteste tous les arguments par lesquels celui-ci affirme que les vallées en question feraient partie du domaine de l’État depuis une époque plus ancienne.
Elle soutient ainsi que la délimitation de la lagune de Venise de 1783 avait été faite pour de simples raisons administratives (déterminer la zone d’application des normes de police hydraulique) et n’avait pas pour objet de délimiter le domaine de l’État ; elle en fait valoir pour preuve la circonstance que des propriétés privées étaient situées à l’intérieur du périmètre de ladite lagune.
Quant au règlement de police de la lagune de 1841, ce n’était pas un acte ayant force de loi mais, explique la requérante, un simple instrument de police lagunaire ; il ne pouvait donc pas, selon elle, constituer la base légale de la domanialité des biens. En outre, ce règlement ne contenait aucune clause affirmant que les biens privés inclus dans la lagune étaient acquis au domaine de l’État ; bien au contraire, il se référait au « propriétaire des vallées » et prévoyait la possibilité d’une expropriation contre le versement d’une indemnité.
Il en irait de même pour la législation postérieure (loi no 3706 de 1877, décrets royaux nos 1090 du 13 novembre 1882, 546 du 22 septembre 1905, 1853 du 18 juin 1936, lois nos 1471 du 31 octobre 1942 et 366 de 1963).
Le gouvernement autrichien avait par ailleurs vendu à des particuliers, selon la requérante, la vallée « Dogado ». En tout état de cause, à la différence de ce qui est prévu dans le CC italien actuel, dans le système juridique de l’Empire austro-hongrois, indique la requérante, tous les biens de l’État pouvaient être vendus et acquis par voie d’usucapion.
33. La requérante affirme que l’inscription de titres de propriété sur les vallées de pêche au cadastre De Bernardi (1842-1843), postérieur au règlement autrichien de 1841, a constitué une confirmation de la reconnaissance de la possibilité, pour les particuliers, de posséder ces biens.
La présente affaire serait ainsi analogue aux affaires Bölükbaş et autres, précitée, et Köktepe c. Turquie ((fond) no 35785/03, 22 juillet 2008), dans lesquelles l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du domaine public n’ont pas empêché la Cour de conclure à l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en considérant que les particuliers pouvaient légitimement se croire en situation de « sécurité juridique » quant à la validité de leurs titres de propriété, inscrits dans les registres fonciers et non contestés pendant de longues années.
Les affaires Depalle c. France et Hamer c. Belgique, citées par le Gouvernement (paragraphes 26 ci‑dessus et 59 ci‑après), seraient en revanche non pertinentes, ayant trait respectivement à un bien dont la domanialité n’était pas contestée et à une construction bâtie sans autorisation.
34. La requérante conteste l’affirmation du Gouvernement (paragraphe 25 ci‑dessus) selon laquelle les actes de l’administration concernant les vallées de pêche qualifieraient leurs destinataires d’ « usagers » – et non de « propriétaires » – de celles-ci.
La circonstance que l’administration ait octroyé des autorisations à une personne désignée comme « prop