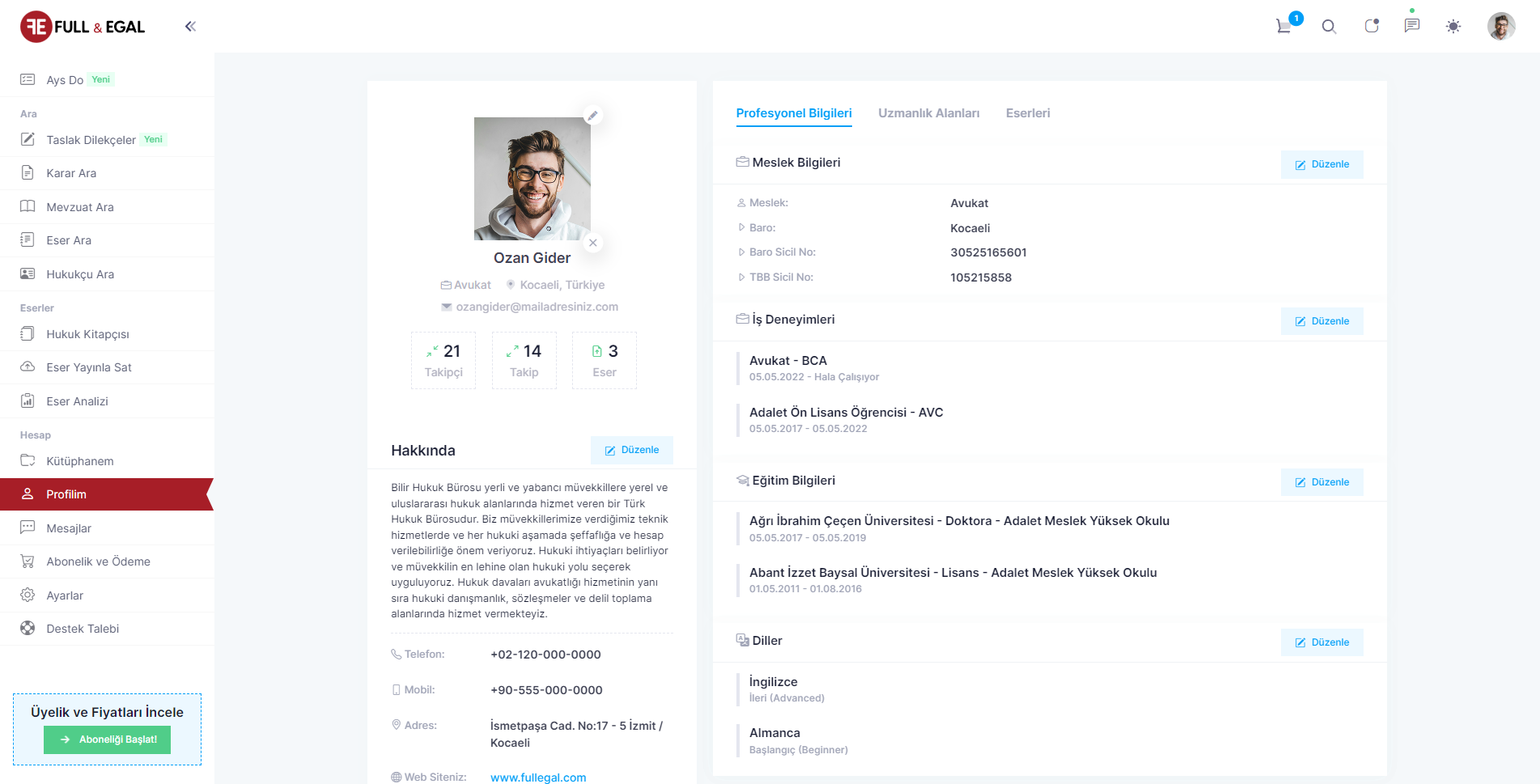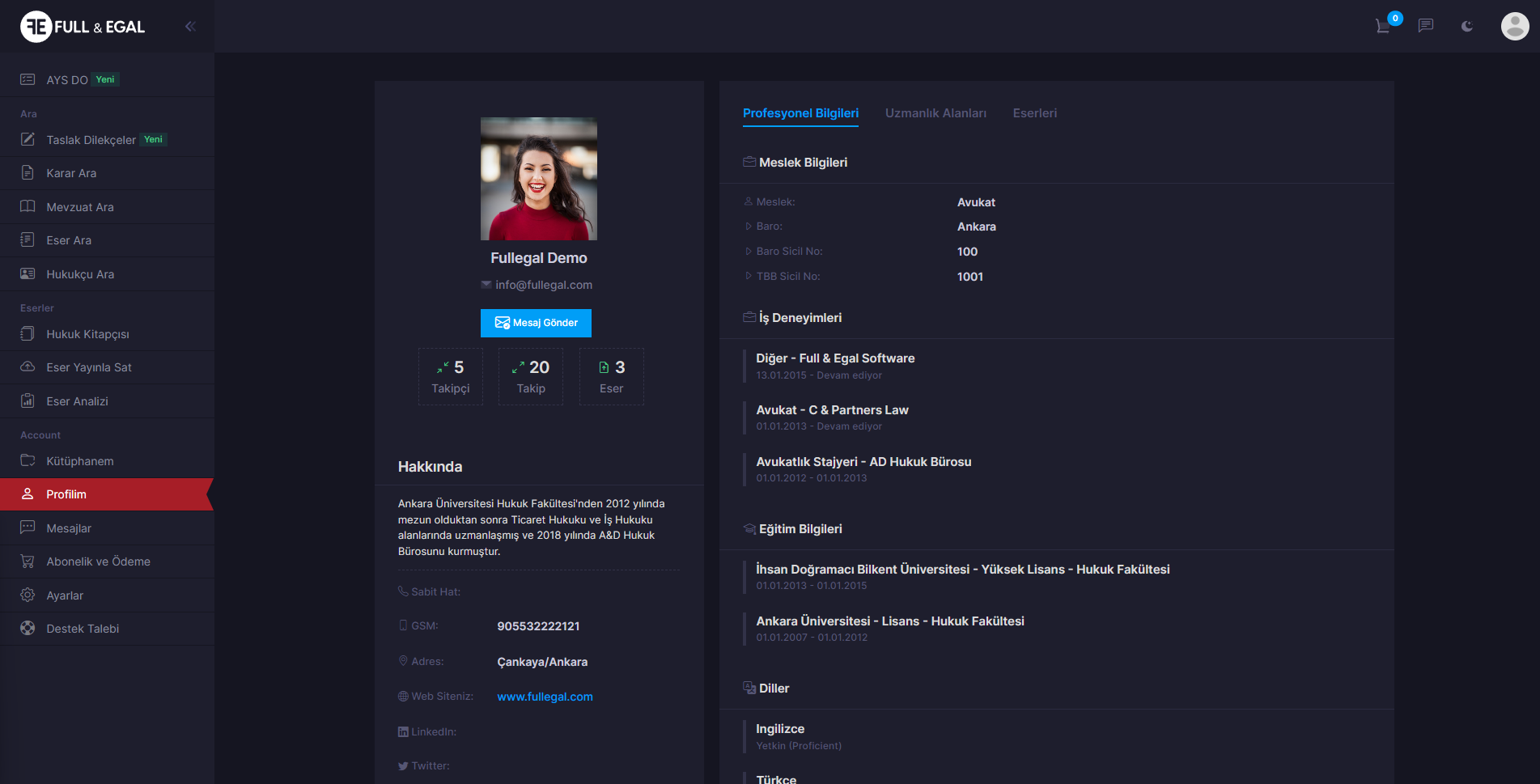DEUXIÈME SECTION
Requête no 16483/12
Saber Ben Mohamed Ben Ali KHLAIFIA et autres
contre l’Italie
introduite le 9 mars 2012
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les requérants sont des ressortissants tunisiens. Les 16 et 17 septembre 2011, M. Khlaifia (le « premier requérant ») et MM. Tabal et Sfar (les « deuxième et troisième requérants ») respectivement, quittèrent avec d’autres personnes la Tunisie à bord d’embarcations de fortune dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Après plusieurs heures de navigation, les embarcations furent interceptées par les garde-côtes italiens qui les escortèrent jusqu’au port de l’île de Lampedusa. Les requérants arrivèrent sur l’île les 17 et 18 septembre 2011 respectivement.
Les requérants furent transférés au Centre d’accueil initial et d’hébergement (CSPA) sis à Contrada Imbriacola où, après avoir reçu les premiers secours, furent identifiés par les autorités.
Ils furent installés dans un secteur du centre réservé aux tunisiens adultes. Les requérants affirment avoir été accueillis dans des espaces surpeuplés et sales et avoir été obligés à dormir à même le sol en raison de la pénurie de lits disponibles et de la mauvaise qualité des matelas. Les repas étaient consommés à l’extérieur, assis par terre. Le centre était surveillé en permanence par les forces de l’ordre, si bien que tout contact avec l’extérieur était impossible.
Les requérants restèrent dans le centre d’accueil jusqu’au 20 septembre, lorsqu’une violente révolte éclata parmi les migrants et, les lieux étant ravagés par un incendie, ils furent transportés dans le camp sportif de Lampedusa pour y passer la nuit. A l’aube du 21 septembre, ils parvinrent avec d’autres migrants à tromper la surveillance des forces de l’ordre et à rejoindre le village de Lampedusa où ils entamèrent, avec 1 800 migrants environs, des manifestations de protestation dans les rues de l’île. Interpellés par la police, les requérants furent reconduits d’abord dans le centre d’accueil et, ensuite, à l’aéroport de Lampedusa.
Le matin du 22 septembre 2011, les requérants furent embarqués dans des avions à destination de Palerme. Une fois débarqués, ils furent transférés à bord de navires amarrés au port de la ville. Le premier requérant monta sur le « Vincent », avec 190 personnes environ, tandis que le deuxième et le troisième requérants furent conduits à bord du navire « Audacia » avec 150 personnes environ.
Sur chaque navire, l’ensemble des migrants fut regroupé dans les salles-restaurant, l’accès aux cabines étant interdit. Les requérants affirment avoir dormi par terre et attendu plusieurs heures pour pouvoir utiliser les toilettes. Ils pouvaient sortir sur les balcons des navires deux fois par jour pendant quelques minutes seulement. Les requérants affirment avoir été insultés et maltraités par les policiers qui les surveillaient en permanence et n’avoir reçu aucune information de la part des autorités.
Les requérants restèrent à bord des navires jusqu’aux 27 et 29 septembre respectivement, dates auxquelles ils furent transportés à l’aéroport de Palerme dans le but d’être rapatriés.
Avant de monter sur les avions, les migrants furent reçus par le consul tunisien. Selon les requérants, celui-ci se serait borné à enregistrer leurs données personnelles, conformément aux accords italo-tunisiens conclus en avril 2011. Aucun document n’aurait été délivré aux requérants tout au long de leur permanence en Italie.
Arrivés à l’aéroport de Tunis, les requérants furent libérés.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions en matière d’éloignement d’étrangers irréguliers
Le décret-loi (decreto legislativo) no 286/98 (« Texte unique des dispositions concernant la règlementation de l’immigration et les normes sur la condition de l’étranger »), tel que modifié par les lois no 271 de 2004 et no 155 de 2005, dispose entre autres :
Article 10 (refoulement)
« 1. La police des frontières refoule (respinge) les étrangers qui se présentent aux frontières sans répondre aux critères fixés par le présent texte unique pour l’entrée dans le territoire de l’Etat.
2. Le refoulement avec accompagnement à la frontière est par ailleurs ordonné par le chef de la police (questore) à l’encontre des étrangers : a) qui rentrent dans le territoire de l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière, lorsqu’ils sont arrêtés au moment de l’entrée dans le territoire ou aussitôt après ; b) qui ont été temporairement admis sur le territoire pour des raisons de secours public. »
Article 13 (expulsion administrative)
« 1. Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’expulsion de l’étranger, même si celui-ci n’est pas résident dans le territoire de l’Etat, en informant préalablement le Président du Conseil des ministres et le ministre des Affaires Etrangères.
2. Le préfet ordonne l’expulsion lorsque l’étranger :
a) est rentré dans le territoire de l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière et il n’a pas été refoulé aux termes de l’article 10 ; (...) ;
8. Contre le décret d’expulsion, l’étranger peut uniquement présenter un recours devant le juge de paix du lieu où l’autorité, qui a ordonné l’expulsion, a son siège. Le délai est de soixante jours à partir de la date de la mesure d’expulsion. Le juge de paix fait droit à la demande, ou la rejette, par décision prise dans les vingt jours à partir du dépôt du recours. Le recours en question peut être signé personnellement et il peut être présenté par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire italienne du pays de destination (...). »
Article 14 (exécution de l’expulsion)
« 1. Lorsqu’il n’est pas possible d’exécuter rapidement l’expulsion par le biais d’accompagnement à la frontière ou le refoulement, car il est nécessaire de secourir l’étranger, d’effectuer des contrôles supplémentaires sur l’identité de l’étranger ou sur sa nationalité ou d’obtenir les documents pour le voyage, ou à cause de l’indisponibilité du transporteur, le chef de la police (questore) dispose que l’étranger soit retenu pendant le temps strictement nécessaire près du centre de permanence temporaire et d’assistance plus proche, parmi ceux identifiés ou constitués par décret du ministre de l’Intérieur, avec les ministres pour la Solidarité Sociale et du Trésor, du Budget et de la Programmation économique. »
2. Les accords bilatéraux avec la Tunisie
Le 5 avril 2011, le gouvernement italien conclut des accords avec la Tunisie en matière de contrôle de la vague d’immigration irrégulière provenant de ce pays.
Le texte de l’accord n’a pas été rendu public. D’après un communiqué de presse publié sur le site internet du Ministère de l’Intérieur italien le 6 avril 2011, la Tunisie s’engageait à renforcer les contrôles de ses frontières dans le but d’éviter de nouveaux départs de clandestins, à l’aide de moyens logistiques mis à disposition par les autorités italiennes.
En outre, la Tunisie s’engageait à accepter le retour immédiat des tunisiens arrivés en Italie après la date de conclusion de l’accord. Les ressortissants tunisiens pouvaient être rapatriés par le biais de procédures simplifiées, prévoyant la simple identification de la personne intéressée de la part des autorités consulaires tunisiennes.
C. Éléments pertinents de droit international
Les faits d’espèce s’inscrivent dans le cadre des arrivées massives de migrants irréguliers sur les côtes italiennes en 2011 à la suite notamment des soulèvements en Tunisie, puis du conflit en Libye.
1. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Dans ce contexte, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe constitua une « Sous-commission ad hoc sur l’arrivée massive de migrants en situation irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du sud de l’Europe », qui effectua une visite d’information à Lampedusa les 23 et 24 mai 2011. Un rapport de visite de la sous-commission fut publié le 30 septembre 2011 dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« (...) 9. En raison de sa position géographique proche des côtes africaines, l’île de Lampedusa a connu plusieurs épisodes durant lesquels elle a dû faire face à de nombreuses arrivées par mer de personnes souhaitant se rendre en Europe (31 252 personnes en 2008, 11 749 en 2007, 18 047 en 2006, 15 527 en 2005).
11. En 2011, suite aux soulèvements en Tunisie, puis en Libye, l’île s’est trouvée confrontée à une nouvelle vague d’arrivées par bateaux. Les arrivées ont repris en 2 temps. En premier lieu, ce sont des Tunisiens qui sont arrivés sur l’île, suivis de bateaux en provenance de la Libye, sur lesquels se trouvaient un grand nombre de femmes et de jeunes enfants. Les arrivées ont commencé le 29 janvier 2011 et rapidement la population de l’île s’en est trouvée multipliée par deux.
12. Suite à ces arrivées, l’Italie a rapidement déclaré l’état d’urgence humanitaire sur l’île de Lampedusa et appelé à la solidarité des Etats membres de l’Union européenne. Des pouvoirs d’urgence ont été confiés au préfet de Palerme pour gérer la situation.
13. A la date du 21 septembre 2011, 55 298 personnes étaient arrivées par la mer à Lampedusa (parmi elles 27 315 de Tunisie et 27 983 de Libye, notamment des Nigériens, des Ghanéens, des Maliens et des Ivoiriens).
VI. Structures d’accueil de Lampedusa
30. Il est essentiel que les transferts vers des centres ailleurs en Italie soient effectués le plus rapidement possible car les capacités d’accueil dont dispose l’île de Lampedusa sont à la fois insuffisantes pour accueillir le nombre d’arrivants et inadaptées à des séjours de plusieurs jours.
31. Lampedusa a deux centres d’accueil : le centre principal à Contrada Imbriacola et la Base Loran.
32. Le centre principal est un centre d’accueil initial et d’hébergement (CSPA). La sous-commission ad hoc a été informée par le Directeur du centre que la capacité d’accueil varie de 400 à 1 000 places. A la date de la visite, le centre hébergeait 804 personnes. Les conditions d’accueil étaient correctes, quoique très basiques. Les pièces étaient remplies de matelas posés les uns contre les autres à même le sol. Les bâtiments, qui sont des blocs préfabriqués, sont aérés puisque les pièces disposent de fenêtres et, lorsque le centre accueille un nombre de personnes correspondant à ses capacités, les sanitaires semblent suffisants.
33. Lors de la visite de la sous-commission, ce centre était scindé en deux parties. L’une était réservée aux personnes arrivant de Libye et aux mineurs non accompagnés (y compris les mineurs non accompagnés tunisiens). L’autre, un centre fermé à l’intérieur du centre (lui-même fermé), était réservée aux adultes tunisiens.
X. Les Tunisiens
51. Lors de la dernière vague d’arrivées, les Tunisiens ont été les premiers à accoster à Lampedusa en février 2011. Ces arrivées ont été problématiques pour plusieurs raisons. Comme indiqué plus haut, les arrivées par mer s’étant considérablement réduites en 2009 et 2010, les centres d’accueil de l’île étaient fermés. Les migrants tunisiens se sont donc retrouvés à la rue, dans des conditions déplorables. Lorsque les centres ont été rouverts, leur capacité d’accueil a immédiatement été saturée. Les Tunisiens ont par la suite été transférés dans des centres de rétention ailleurs en Italie, puis, une fois ceux-ci saturés à leur tour, dans des centres d’accueil ouverts prévus pour les demandeurs d’asile.
52. Le fait que les Tunisiens soient dans leur quasi-totalité des migrants économiques et la difficulté à organiser des